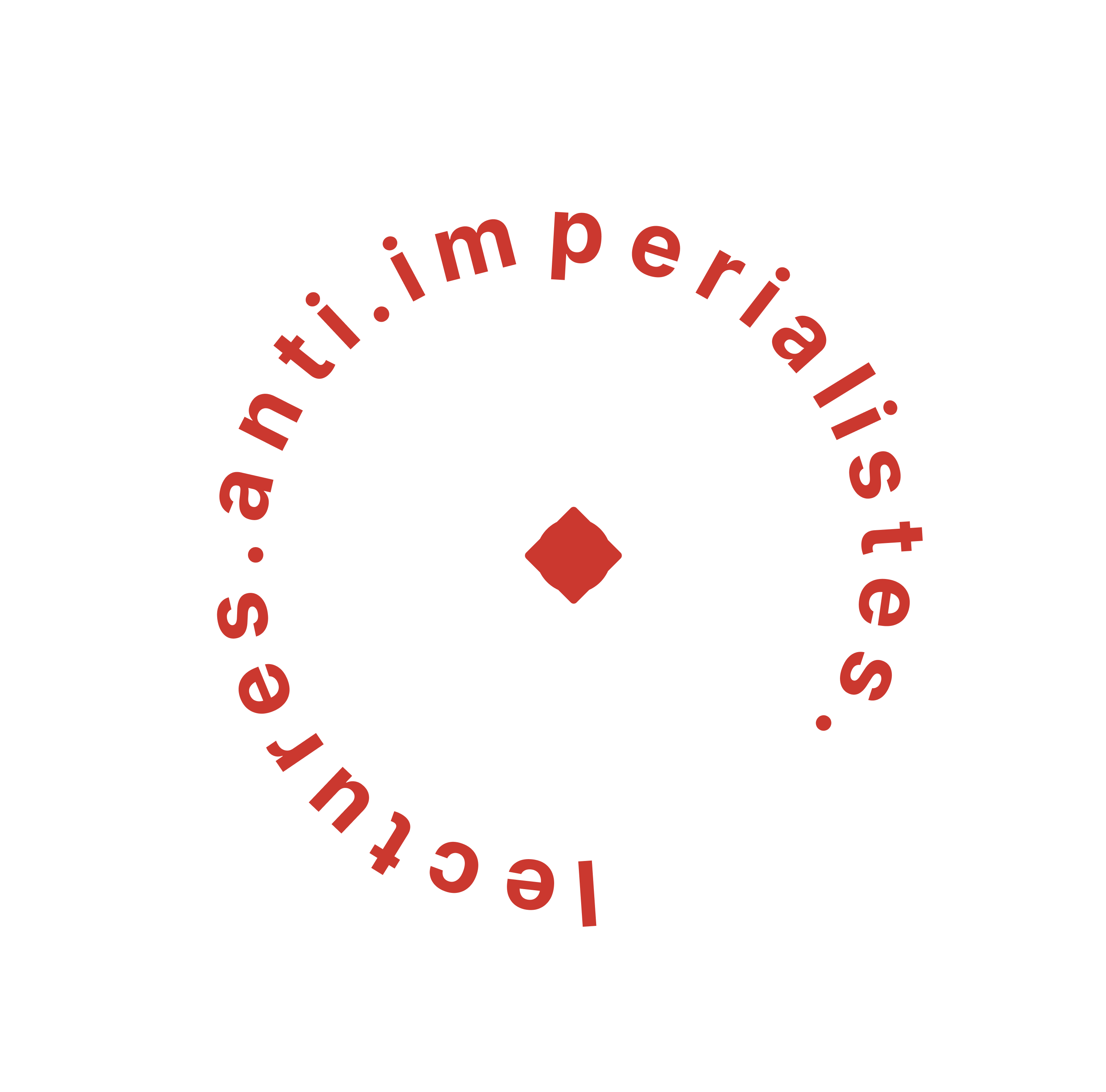Extractivisme et échange inégal.
Même si elle prend une importance croissante dans les débats à gauche, l’extractivisme est une notion encore mal définie. Nous en proposons ici une approche qui s’intéresse aux dynamiques impérialistes qui sous-tendent et qui sont permises par l’extractivisme, de l’échange inégal au colonialisme.
Introduction
L’extractivisme est un concept issu du Sud Global. Il tire son origine du mot portugais « extrativismo » qui renvoie à l’origine aux activités commerciales réalisées avec des produits forestiers, et exportés vers les métropoles capitalistes. Il s’agit donc d’un usage capitaliste des ressources forestières, qui s’oppose au sens large aux activités de subsistance. Dans cette acception, l’activité paradigmatique de l’extractivisme est la culture de l’hévéa pour la production de caoutchouc, dans un contexte colonial. De façon plus actuelle, on peut définir avec l’économiste équatorien Alberto Acosta l’extractivisme de la façon suivante :
« Les activités qui extraient d’importantes quantités de ressources naturelles qui ne sont pas transformées (ou qui le sont seulement dans une faible mesure) principalement destinées à l’export. L’extractivisme ne se limite pas seulement aux minerais ou au pétrole, il est également présent en agriculture, en sylviculture, ainsi que dans le secteur de la pêche[01] ».
Malgré la dimension fondamentale de ce concept, l’extractivisme est peu débattu dans le débat public. Il nous semble que cette absence s’explique par deux raisons :
– Pour des raisons économiques et matérielles : les industries extractives ont été éjectées hors du centre, en particulier pour l’Europe.
– Pour une raison politique : l’abandon de toute théorie économique anti-impérialiste conséquente de la part de nombreux mouvements politiques, particulièrement dans le Nord Global, à partir des années 1990.
L’externalisation des industries extractives hors du Nord Global et la dépendance massive de ce même Nord aux carburants fossile explique pourquoi c’est par la question du “pic pétrolier” (c’est-à-dire du risque d’épuisement des ressources en pétrole) que l’extractivisme a été abordé dans le débat public, sans pour autant s’imposer comme thème central. Bien au contraire, ce regard angoissé sur les ressources s’inscrit parfaitement dans une dynamique qui motive d’autant plus les politiques extractivistes.
La seconde raison correspond à une volonté de renouer avec des épistémologies locales, dans la poursuite salutaire d’une critique de l’eurocentrisme des savoirs. En effet, les critiques de l’extractivisme ont parfois tendance à attribuer son émergence à un simple changement de rapport intellectuel à la nature, venant par exemple de philosophes comme Francis Bacon[02].
Il apparaît cependant que c’est bien à travers la critique de l’économie politique que la remise en cause de l’eurocentrisme et de ses théories biaisées du « développement » est possible[03]. Le but de ce texte est donc de replacer au cœur du débat cette démarche critique, rendue possible par l’économie politique, appliquée à l’extractivisme. Il s’agit de poser les bases d’une intervention politique sur l’extractivisme dans un contexte où il devient aujourd’hui un enjeu stratégique central, ceci tant pour les États du Sud que pour ceux du Nord, face aux perturbations des chaînes globales de valeur – initiées par la guerre commerciale de Trump et la pandémie de Covid-19 et prolongées par d’autres moyens.
L’extractivisme a été et est encore souvent étudié à un niveau local, dans une perspective anthropologique, notamment pour montrer comment il détruit les structures sociales et en particulier la subsistance des communautés. Cependant, les ressources dont il est question ont une relation symbiotique avec l’économie mondiale[04], puisque les produits de l’extractivisme forment de fait la base matérielle de l’espace économique international. Au début des années 2020, environ 60% des pays étaient dépendants d’une marchandise extractive, le plus souvent destinée à la production de carburants[05]. Cette dépendance tend à s’accélérer avec l’augmentation de l’extraction dans tous les scénarios envisagés par l’Agence Internationale de l’énergie[06].
La prise en compte de cette échelle globale est indispensable pour ne pas se limiter à une lecture idéologique et/ou cosmologique de l’extractivisme, qui se limiterait à de l’histoire des idées. En ce qui concerne notre perspective, c’est plutôt le déploiement de la loi de la valeur au niveau mondial qui explique ce devenir extractiviste du globe. Plutôt que de proposer une analyse conceptuelle ou philosophique approfondie de ce qu’est l’extractivisme, nous nous concentrerons plutôt sur les dynamiques économiques et politiques qui le rendent possible, tant dans l’histoire du capitalisme que dans la période actuelle. Période qui se caractérise par une compétition exacerbée entre les États pour le contrôle de certaines matières premières, comme le lithium.
LIMITES DE LA THEORIE CLASSIQUE
A. L’approche de l’économie classique.
La première question à saisir est celle de la « richesse » tirée des activités extractives et de ses fondements. Pour l’économie politique classique, l’objectif de l’extractivisme est la rente, comme expliqué par David Ricardo[07].
La rente ricardienne désigne le surplus économique généré par l’exploitation de ressources naturelles rares ou de haute qualité. Certaines ressources, comme les gisements miniers ou pétroliers, sont plus faciles et moins coûteuses à exploiter, générant des profits excédentaires – au début du XIXe, en l’absence d’industrie pétrolière, Ricardo prend pour exemple les terres agricoles. Les industries extractives tirent des rentes élevées des ressources les plus riches ou les mieux situées. Aussi, ce mécanisme reposerait non pas sur l’innovation ou l’amélioration de la productivité, mais sur les caractéristiques naturelles des ressources elles-mêmes et leur emplacement stratégique. Tout comme les propriétaires fonciers profitent passivement de la fertilité naturelle des terres, les industries extractives capitaliseraient sur la localisation des ressources. Cela pousserait également à exploiter intensivement les ressources, sans investir dans leur transformation ou dans des pratiques plus durables. A cette fin, l’objectif central est la recherche des gisements les plus rentables, afin de maximiser cette rente – raison pour laquelle les sociétés minières investissent des sommes considérables dans des modèles d’IA de prospection minière.
Dans la théorie économique classique, la rente ricardienne peut également être éclairée par la théorie des avantages comparatifs, qui soutient que les pays devraient se spécialiser dans la production de biens pour lesquels ils ont le coût d’opportunité[08] le plus faible, même s’ils ne détiennent d’avantage absolu dans aucun domaine. Les pays riches en ressources naturelles se concentrent souvent sur l’extraction et l’exportation de ces ressources, car cette dernière est censée représenter leur spécialisation la plus rentable. Cette spécialisation permet, d’après la théorie de Ricardo, de générer des gains mutuels du commerce, car les pays exportateurs de ressources peuvent échanger ces matières premières contre des biens manufacturés ou technologiques qu’ils ne produisent pas eux-mêmes à un coût compétitif.
Que vaut cette théorie pour parler de l’extractivisme ? Car comme souvent, les choses sont bien plus compliquées et tortueuses que dans les théories des économistes classiques.
B. Les problèmes de l’extractivisme selon l’économie classique.
Le premier effet de cette spécialisation dans des ressources extractives pour les économies nationales c’est ce qu’on appelle la « maladie hollandaise »[09]. La maladie hollandaise décrit une distorsion économique où les investissements sont massivement redirigés vers l’extraction de ressources naturelles, ce qui modifie profondément la structure économique du pays. Parallèlement, les secteurs produisant des biens échangeables, comme l’industrie manufacturière ou l’agriculture diversifiée, subissent un déclin. L’appréciation de la monnaie nationale, due aux revenus élevés générés par les exportations de ressources, rend les autres biens plus chers à produire localement et donc moins compétitifs à l’international, favorisant leur importation. Cette dépendance au secteur extractif rend l’économie particulièrement vulnérable, car après un boom des ressources, la rigidité des prix et des salaires complique l’ajustement économique et freine la reprise.
La rente ricardienne et l’extractivisme s’inscrivent également dans le cadre de la soi-disant « malédiction des ressources », un phénomène où l’abondance de ressources naturelles peut paradoxalement freiner le développement économique. C’est ce que l’on appelle la « croissance appauvrissante » (immiserizing growth), où une augmentation de la production de ressources naturelles peut entraîner une baisse du bien-être économique global[10]. Les rentes ricardiennes élevées, générées par la rareté ou la qualité des ressources, créent des profits importants, encourageant une surproduction lorsque les prix mondiaux sont élevés. Pendant les crises économiques, la pression pour compenser la baisse des prix pousse à augmenter encore davantage les taux d’extraction, pour que la masse des profits permette de rattraper la baisse de leur taux. Cependant, cette stratégie conduit souvent à un excès d’offre sur les marchés mondiaux, ce qui fait chuter les prix des ressources, réduisant leur valeur et exacerbant les déséquilibres économiques.
Ainsi nous voyons que même en restant dans les rivages de l’économie pure, l’extractivisme ne semble pas du tout permettre le développement et même l’empêcher. Néanmoins, une analyse aussi abstraite n’est pas suffisante : déjà parce que la catégorie de malédiction pose problème. En effet, il est inimaginable qu’une ressource à elle seule maudisse un pays par ses seules propriétés. Il est donc nécessaire de passer par une analyse de l’histoire et des rapports de forces concrets pour en arriver à une analyse satisfaisante de l’extractivisme[11].
IMPERIALISME ET EXTRACTIVISME
Il faut en effet comprendre cette spécialisation – de l’extraction de ressources naturelles sur certains territoires – dans le cadre de l’impérialisme. La définition de l’impérialisme par Rosa Luxembourg est absolument décisive pour comprendre les fondements de l’extractivisme :
« L’impérialisme est l’expression politique du processus de l’accumulation capitaliste se manifestant par la concurrence entre les capitalismes nationaux autour des derniers territoires non capitalistes encore libres du monde. »[12]
C’est en particulier sur cette question que la théorie globale de l’extractivisme converge vers les théories locales de l’extractivisme, qui insistent souvent sur les phénomènes de fronts pionniers. L’impérialisme est un processus de constitution d’espaces géographiques différenciés dans l’accumulation du capital. Cependant, ce que nous voulons caractériser ici, c’est la logique économique qui sous-tend ces formes d’exploitation.
Il nous semble en effet insuffisant de réduire ces processus d’exploitation aux caractéristiques naturelles de ces territoires – comme le suggère l’expression de « malédiction des ressources » – ou aux conflits qui opposent des groupes sociaux selon des rapports différenciés au milieu de vie : d’un côté, des attitudes holistes, et de l’autre, des attitudes prédatrices des colons ou des sociétés minières en situation postcoloniale ou néo-coloniale. Bien que les caractéristiques naturelles et culturelles locales de la situation extractive soient indispensables pour rendre l’extraction possible, ce que nous voulons montrer, c’est que l’extractivisme dépend avant tout des tendances et des fluctuations du mode de production capitaliste. Un des traits majeurs de ce mode de production est le développement inégal et combiné.
Le développement inégal et combiné.
Partons de ce que Trotsky appelle le développement combiné :
« La loi rationnelle de l’histoire n’a rien de commun avec des schémas pédantesques. L’inégalité de rythme, qui est la loi la plus générale du processus historique, se manifeste avec le plus de vigueur et de complexité dans les destinées des pays arriérés. Sous le fouet des nécessités extérieures, la vie retardataire est contrainte d’avancer par bonds. De cette loi universelle d’inégalité des rythmes découle une autre loi que, faute d’une appellation plus appropriée, l’on peut dénommer loi du développement combiné, dans le sens du rapprochement de diverses étapes, de la combinaison de phases distinctes, de l’amalgame de formes archaïques avec les plus modernes. A défaut de cette loi, prise, bien entendu, dans tout son contenu matériel, il est impossible de comprendre l’histoire de la Russie, comme, en général, de tous les pays appelés à la civilisation en deuxième, troisième ou dixième ligne. »[13]
L’idée générale est que l’impérialisme fonctionne selon une double dynamique :
1) Intégration au système monde sous « le fouet des nécessités extérieures », c’est-à-dire l’imposition de l’accumulation capitaliste.
2) Cette intégration repose sur le maintien des différents États, mais aussi sur le maintien de leurs spécificités.
Cette deuxième dynamique est celle qui permet de maintenir un taux moyen de profit au niveau international grâce à la différence locale des taux de profit, ce qui permet de créer de nouveaux espaces où se déroule un segment ou un autre de l’accumulation capitaliste.
Cependant, cette logique ne s’applique pas seulement aux territoires éloignés des centres capitalistes. Elle se déploie à l’intérieur même des puissances capitalistes, où certains territoires servent de colonies intérieures – ou de régions subsidiaires. Il existe de nombreux exemples historiques de tels espaces en Europe. Par exemple, les Flandres belges, ou, après l’indépendance de 1830, la petite industrie du lin a été balayée par les grands centres industriels. Dans les Flandres comme ailleurs, la désindustrialisation de ces espaces s’accompagne de l’émergence d’un chômage de masse, de phénomènes d’émigration et d’appauvrissement général.
Ernest Mandel décrit ce phénomène dans de nombreux pays européens et souligne que la ressemblance entre ces inégalités dans le développement n’est pas seulement formelle : l’existence de ces territoires est constitutive du processus d’accumulation capitaliste, et ce pour deux raisons. D’abord, elle permet de constituer un échange inégal entre ces périphéries et les centres industriels, c’est-à-dire entre des produits bruts à faible valeur ajoutée et des produits manufacturés à forte valeur ajoutée. Ensuite, Mandel ajoute que ces territoires servent aussi de base à la constitution d’une armée de réserve séculaire[14].
Malgré toutes les différences que l’on peut souligner avec ce processus propre au XIXe siècle, il est tentant d’établir des similitudes avec le retour des mines dans le Nord Global, et particulièrement en France avec le projet d’Echassières. De la même manière que certains territoires européens ont été relégués au second plan lorsque le capital a privilégié d’autre centres plus compétitifs, le territoire d’Echassières, marqué par le chômage et la désindustrialisation depuis plusieurs décennies, semble aujourd’hui être réintégré dans un nouveau cycle d’accumulation capitaliste. [notes du groupe de lecture : la mention de ce territoire est liée à l’activité du collectif d’enquêtes Strike, avec lequel nous écrivons cette introduction]
FONDEMENTS DE L’ECHANGE ECOLOGIQUE INEGAL
A. L’échange inégal.
La question à laquelle cherche à répondre la théorie de l’échange inégal adopte toutefois une perspective différente. Il ne s’agit plus comme nous avons pu le lire chez Trotsky, en ce qui concerne le développement inégal et combiné (DIC), de dégager une loi rationnelle de l’histoire, mais de répondre à la question suivante : le sous-développement peut-il s’expliquer par des facteurs institutionnels endogènes tels que la bonne gouvernance, le libre marché et des institutions fortes ?
La thèse générale de l’échange inégal est que le sous-développement s’explique par l’appropriation massive de valeur provenant du Sud par le Nord, ou de la périphérie au centre, en particulier durant la période coloniale, bien que cette dynamique se poursuive aujourd’hui, notamment avec l’échange écologique inégal.
L’intérêt fondamental de cette théorie est qu’elle permet de sortir des représentations purement historicistes en s’inscrivant dans une analyse quantitative, et non plus qualitative, dans laquelle le sous-développement prend les traits de l’arriération dans une perspective culturaliste ou civilisationnelle. En quantifiant la valeur des ressources appropriées au Sud par le biais d’échanges inégaux depuis les années 1960, on confirme que la croissance économique et les niveaux élevés de consommation dans le Nord ne sont possibles que grâce à l’extraction de richesses dans d’autres parties du monde, en particulier depuis les années 1980[15].
Ensuite, de même que les théories classiques de l’impérialisme étaient une réponse à la théorie du doux commerce de Montesquieu, l’échange inégal répond à une théorie libérale du commerce international : la théorie de David Ricardo des avantages comparatifs, qui fournit la justification idéologique à la spécialisation extractive.
Cette justification idéologique trouve une expression concrète dans la manière dont les prix sont fixés au niveau global. En raison du contrôle monopolistique que les pays riches exercent sur l’économie mondiale, ils sont en mesure de vendre des produits de base sur le marché mondial à des prix supérieurs à leur prix de production, alors que pour les économies périphériques, les prix sont souvent inférieurs aux prix de production. Cela crée un transfert de valeur des économies en développement de la périphérie vers les économies centrales, mettant en place un mécanisme structurel d’échange inégal. Avec l’immobilité des facteurs, on assistait à une inversion totale de fonction :
« Ce n’étaient plus les conditions de la production qui déterminaient les échanges, mais les échanges qui déterminaient la production. C’est cette inversion, ce reniement de la valeur-travail, qui explique en partie l’unanimité dont nous avons parlé ci-dessus [unanimité des marginalistes pour épargner la construction ricardienne de la loi des coûts comparatifs][16]»
Comment classifier et quantifier cet échange inégal ?
Köhler[17] soutient que le transfert de valeur doit être mesuré en termes de prix du Nord. Autrement dit, la valeur de la quantité physique de travail et de ressources que le Nord s’approprie du Sud doit être représentée en termes de prix de cette quantité dans le Nord. Cette approche est valable dans la mesure où les prix du Nord servent de référence pour la « valeur », notamment dans les calculs de parité de pouvoir d’achat et dans l’analyse des données sur la consommation des ménages, qui sont au cœur de l’économie du développement.
Pour quantifier le transfert de valeur[18], Köhler utilise l’équation suivante :
T = d *X – X
tel que :
T = transferts par échange inégal
X = gains du Sud sur les exportations vers le Nord
d = facteur de distorsion , càd rapport entre les prix du Nord et les prix du Sud
C’est bien sûr cette variable d qui est décisive, puisque l’échange inégal vise à montrer qu’au-delà de la domination coloniale, le système international des prix perpétue l’appropriation des ressources du Sud comme condition du développement économique des pays du Nord.
Les prix sont naturalisés au motif qu’ils représentent « l’utilité », ou la « valeur », ou le résultat des « mécanismes du marché » tels que l’offre et la demande. Mais cette interprétation occulte la manière dont ils sont en réalité déterminés par les déséquilibres de pouvoir de l’économie politique mondiale. Ainsi, les écarts de prix dans le commerce international fonctionnent comme une méthode efficace d’appropriation de ce qui autrefois était approprié ouvertement, via l’économie coloniale. Ce système permet alors d’imputer le « sous-développement » aux victimes elles-mêmes.
Mais alors comment comprendre cette distorsion d’un point de vue quantitatif ? Deux approches sont possibles : la première, proposée par Samir Amin, se fonde sur les inégalités salariales au niveau mondial[19]. La seconde, développée par Köhler, s’appuie sur les taux de change du marché (TCM) et la parité de pouvoir d’achat (PPA) comme indicateur des inégalités de prix globales.
Bien sûr, calculer le drainage occasionné par l’échange inégal à partir de la seule valeur a de nombreuses limites. Tout d’abord, les indices utilisés pour calculer la distorsion internationale des prix sont eux-mêmes distordus. Ensuite, cette approche est particulièrement abstraite en ce qu’elle se fonde sur les balances commerciales et les différentiels de prix pour rendre compte d’activités bien concrètes de drainage, notamment à travers l’extractivisme, sans jamais faire référence aux biens qui sont concrètement drainés. Enfin, les métriques employées ne rendent pas compte du travail contenu dans les intrants, qui sont simplement comptabilisés comme des intrants et non comme des facteurs de production.
Or, la question du franchissement des limites planétaires nous pousse à dépasser la simple analyse du transfert de valeur. L’extractivisme, en particulier, se pose systématiquement d’un point de vue concret puisqu’au-delà des théories de la valeur, les matières extraites ont des propriétés exploitables dans l’industrie, ce qui les rend critiques.
B. La rupture métabolique.
La théorie de la rupture métabolique provient des cahiers de Marx, et en particulier des cahiers d’agronomie et de chimie consacrés au chimiste organique Justus Liebig. Cette théorie, qui est au fondement du « Marx écologiste », n’est pas une lubie du XXIe siècle visant à sauver Marx, mais une lecture qui provient avant tout du bloc de l’Est. C’est en particulier la réception, en 1972, du rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance qui a poussé à la relecture de ce Marx qui théorise notamment l’épuisement des sols. A ce titre, il convient de citer le hongrois István Mészáros[20], de l’école de Budapest, et Wolfgang Harich en RDA, bien que tous deux ne s’inscrivent pas dans les courants officiels du marxisme d’État.
La notion fondamentale de Marx pour penser l’échange écologique inégal est celle de Stoffwechsel, que l’on traduit en français par « métabolisme », bien que ce terme renvoie plus exactement à la notion d’échange de matière. C’est d’ailleurs sur cela que portait les réflexions de Liebig à l’époque. On retrouve aussi une définition dans le livre I du Capital :
« Le travail est d’abord un procès qui se passe entre l’homme et la nature, un procès dans lequel l’homme règle et contrôle son métabolisme avec la nature par la médiation de sa propre action »[21]
L’idée fondamentale du marxisme écologique est que le métabolisme entre la nature et la société, qui caractérise le mode de production capitaliste, conduit inévitablement à un effondrement de lui-même. Pour Mészáros, le métabolisme social capitaliste est à l’origine d’une contradiction interne :
« […] les limites du capital ne peuvent plus être conceptualisées comme de simples obstacles matériels à une plus grande augmentation de la productivité et de la richesse sociale, et donc comme un frein au développement, mais comme un défi immédiat pour la survie même de l’humanité. Et dans un autre sens, les limites du capital peuvent se retourner contre lui en tant qu’organe de contrôle surpuissant du métabolisme social […] lorsque le capital n’est plus en mesure d’assurer, par quelque moyen que ce soit, les conditions de son autoreproduction destructrice et provoque ainsi l’effondrement du métabolisme social global. »[22]
Il existe ainsi une rupture dans la circulation matérielle au sein du cycle métabolique de la nature. L’exemple pris par Marx est celui de la rupture de la circulation des nutriments du sol. L’agriculture capitaliste moderne cherche à maximiser l’absorption des nutriments par les plantes, le plus rapidement possible, afin qu’elles puissent être vendues comme marchandises aux clients des grandes villes.
Cette perturbation du métabolisme entre la société et la nature compromet les conditions écologiques naturelles d’une agriculture durable et provoque, dès le XIXe, un épuisement généralisé des sols en Europe et aux États-Unis. Liebig a sévèrement critiqué ce type de maximisation du profit à courte vue, qu’il qualifia d’« exploitation prédatrice ». Son intuition fondamentale demeure pertinente, puisque c’est précisément ce à quoi l’on assiste aujourd’hui avec la perturbation du cycle global de l’azote et du phosphore.
Ce niveau fondamental de rupture métabolique, sous la forme d’une perturbation du flux matériel, ne peut se produire sans être complété par deux autres aspects :
D’abord, cette rupture est spatiale. Marx a problématisé ce clivage propre à l’organisation capitaliste de l’espace sous le nom d’« opposition entre la ville et la campagne ». L’exploitation ne saurait exister sans une division sociale du travail reposant sur la concentration de la classe ouvrière dans les grandes villes, et sur la nécessité émergente d’acheminer en permanence de nourriture depuis les campagnes vers les centres urbains. C’est la séparation spatiale antagoniste au sein même d’un pays capitaliste. Cette division entre villes et campagnes introduit une dissociation entre les lieux de consommation et les lieux de production agricole — rendant impossible toute forme de circulation des nutriments. Les déchets organiques issus de l’alimentation urbaine ne retournent plus aux champs. Cette dissociation spatiale amène ainsi une rupture dans la circulation matérielle au sein du cycle métabolique de la nature.
Ensuite, cette rupture est temporelle, qui se manifeste dans la disjonction fondamentale entre les rythmes longs de la nature — comme la formation des nutriments du sol, des combustibles fossiles ou des minéraux — et le rythme du capital, fondé sur l’accélération constante du temps de production. Alors que les cycles naturels exigent des temps longs, parfois géologiques, le capital tente constamment de raccourcir son temps de rotation[23] pour maximiser sa valorisation. Ce procès s’accompagne inévitablement de l’expansion du capital flottant, sous la forme de matières premières et d’intrants auxiliaires, mobilisés pour alimenter l’accélération de cette temporalité. En parallèle, le capital révolutionne sans cesse le procès de production, augmentant les forces productives à un rythme effréné. Celles-ci peuvent doubler, tripler grâce à l’introduction de nouvelles technologies, mais la nature, elle, ne peut adapter ses cycles à cette cadence : elle ne peut ni accélérer la formation du phosphore, ni celle du charbon ou du pétrole.
En fin de compte, la nature ne peut pas rattraper la vitesse du capital. Il en résulte une divergence irréductible entre deux régimes de temps – celui de la nature, long, structuré par des rythmes souvent incompressibles ; et celui du capital, rendu toujours plus court par les impératifs de l’accumulation.
Marx illustre cette contradiction avec l’exemple de la déforestation, en soulignant que la longue rotation de la sylviculture est peu compatible avec la temporalité du capital :
« La longue durée du temps de production (qui ne comprend qu’un temps de travail relativement restreint) et, par suite, la longueur des périodes de rotation font de la sylviculture quelque chose de peu propre à l’exploitation privée et par conséquent à l’exploitation capitaliste, cette dernière étant essentiellement une exploitation privée, même quand le capitaliste individuel est remplacé par le capitaliste associé. Du reste, le développement de la culture et de l’industrie a de tout temps agi si fortement pour la destruction des forêts que tout ce qu’il a fait en revanche pour leur conservation et leur plantation n’est qu’une quantité absolument négligeable. »[24]
Ce que montre Marx à travers l’exemple de la sylviculture, c’est que le capital ne peut exploiter les ressources naturelles que s’il rompt avec les temporalités propres aux cycles de la nature. Autrement dit, la perturbation du flux matériel — ce niveau fondamental de la rupture métabolique — advient car il y a une rupture des rythmes naturels, que le capital doit accélérer, comprimer ou ignorer pour assurer la continuité de son propre cycle d’accumulation.
C’est dans une perspective analogue qu’il faut comprendre l’échange écologique inégal. Toutefois, il ne s’agit plus ici d’une rupture métabolique au sein d’un même état-nation, ou d’un même territoire : c’est la rupture entre Nord et Sud qui produit la destruction de la nature. C’est l’accélération de l’exploitation au mépris du rythme de reproduction des ressources naturelles des pays du sud ; c’est l’accumulation dans le nord grâce à l’extraction et la destruction écologique dans le sud.
L’ECHANGE ECOLOGIQUE INEGAL
L’échange écologique inégal (EEI) peut être compris à la fois comme une adaptation contemporaine de la théorie économique de l’impérialisme, et comme une concrétisation des élaborations de l’échange inégal évoquées précédemment, qui ne permettaient jusqu’alors que d’observer indirectement le phénomène d’appropriation structurelle des ressources et du travail du Sud par les économies du Nord.
Dans l’échange inégal, tel que formulé notamment par Samir Amin, la source de l’extorsion de valeur réside dans le fait que la force de travail mobilisée dans le Sud n’est pas rémunérée au même niveau que celle du Nord. Le transfert de valeur est ainsi estimé en valorisant le travail effectué dans le Sud aux prix salariaux du Nord. Cette méthode permet de rendre visible une extorsion implicite, mais elle reste, en un sens, abstraite : elle ne saisit ni la matérialité des ressources mobilisées, ni les impacts écologiques et sociaux associés à leur extraction. Ainsi, chez Amin, le rapport entre le prix différencié de la force de travail et le prix mondial d’une marchandise (par exemple le pétrole) devient un indicateur de cette asymétrie structurelle[25]. Cette ressource stratégique est extraite dans le Sud à faible coût, mais son prix est fixé sur les marchés du Nord. Dès lors, ce qui est produit dans le Sud ne donne lieu qu’à une faible contrepartie monétaire, tandis que les économies du Nord captent l’essentiel de la valeur d’échange en aval de la chaîne.
L’apport fondamental de la théorie de l’échange écologique inégal est de s’intéresser à ce drainage avant même sa transformation monétaire, en suivant les flux de matière et d’énergie. Comme le soulignent Jason Hickel et ses collègues[26], les prix internationaux reflètent avant tout les rapports de force sur le marché mondial : ils sont déconnectés des volumes réels de matière, d’énergie ou de travail, et tendent à invisibiliser les contributions non rémunérées ou indirectes à la production globale, ainsi que les effets sociaux et écologiques associés.
Le paradigme de l’échange écologique inégal, se doit donc de dépasser cette approche centrée sur la valeur de la force de travail pour proposer une analyse physique, c’est-à-dire basée sur des unités mesurables de matières, d’énergie, de surfaces cultivables ou encore d’heures de travail. Il s’agit donc d’évaluer les échanges Nord-Sud à l’aune de leur contenu matériel et de leur dimension environnementale. Cette perspective permet de montrer que des volumes immenses de ressources sont extraits dans le Sud pour satisfaire la consommation dans le Nord, à des prix inférieurs à leur valeur sociale et écologique réelle.
Pour présenter la théorie de l’EEI nous nous appuierons principalement sur les résultats d’un article de 2022 publié par Jason Hickel et des co-auteurs. Leur analyse s’appuie d’abord sur le calcul physique du drainage – c’est-à-dire des ressources concrètes mobilisées dans le Sud pour produire des biens, dont l’utilité est captée par le Nord.
Il y a quelque chose de très concret et évident à parler de ce drainage en termes physiques, c’est-à-dire que ce qui a été accumulé à un endroit à été pris à un autre. En l’occurrence, dans le système impérialiste, cette appropriation se fait du Sud vers le Nord. Compter des quantités physiques permet de comprendre de quoi l’on parle précisément quand on parle de drainage. Par exemple dans le Nord Global, de la terre peut être consacrée à l’élevage bovin intensif et générer une forte valeur ajoutée et une alimentation locale. Cette production n’est possible que parce qu’en Amérique du Sud, la même surface est exploitée pour des monocultures de soja destinées à l’exportation, avec une moindre rentabilité locale et des effets écologiques délétères. Si ces phénomènes sont bien connus, le paradigme de l’EEI permet de les représenter de façon hautement agrégée et donc macroscopique.
Ce calcul des transferts physiques permettra ensuite d’évaluer la distorsion amenée par le marché, en comparant l’échelle physique des flux nets de ressources aux écarts de prix mondiaux. Autrement dit, il s’agit de confronter les volumes concrets de ressources exportées avec la valorisation de ces flux. On part du drainage de matière pour le retraduire ensuite en termes de drainage de valeur.
Dans l’article que nous mobilisons ici, Hickel, Dorninger, Wieland et Suwandi procèdent à cette analyse en examinant les flux commerciaux directs et indirects entre les économies avancées et le reste du monde, en suivant quatre catégories principales[27] :

« les matières, mesurées en « équivalents matières premières » (EMR), c’est-à-dire les besoins totaux en matières premières en amont (directs et indirects) liés à la production de biens et de services (mesurés en gigatonnes [Gt]) (Wiedmann et al., 2015) ;
les terres : la superficie totale nécessaire à la production (mesurée en millions d’hectares [mn ha]) (Bruckner et al., 2015) ;
l’énergie : l’énergie primaire nécessaire à la production (mesurée en Exajoules [EJ]) (Chen et al., 2018) ;
le travail : la main-d’œuvre mobilisée dans les chaînes de valeur mondiales (mesurée en millions de personnes-années [mn p-yeq]) (Alsamawi et al., 2014).»
Tout d’abord, ce graphique montre, du point de vue du Sud global, l’échange net (exportations-importations) de ressources physiques. Cela nous permet de constater que tous les indicateurs sont en déficit constant pour le Sud, indiquant une extraction de ressources par le Nord.
Ensuit, le tableau suivant présente cette extraction rapporté à la consommation totale du Nord :

On observe qu’en 2015, 43 % des matières premières consommées dans le Nord provenaient du Sud, 30 % du travail, 21 % des terres, et 10 % de l’énergie. Ces proportions se maintiennent de façon élevée sur l’ensemble de la période 1990-2015.
Une fois ces drainages matériels évalués, il est possible de traduire en compte monétaire cette appropriation en reprenant l’équation de Kohler, mentionnée plus haut dans l’article, sous une forme modifiée :
T = Rnet * PN – Mnet
T = transferts de valeur par échange inégal
Rnet = drainage net de ressources du Sud vers le Nord
PN = prix d’exportation du Nord par unité de ressource
Mnet = transferts monétaires nets du Nord vers le Sud
Par exemple, en reprenant le tableau précédent, si en 2015, 630 millions de personnes-années de travail ont été drainées du Sud, et que l’on valorise ce travail au prix moyen du Nord (disons 30 000 $/an[28]), cela représente à lui seul 18 900 milliards de dollars. Cette possibilité de quantification qu’offre l’EEI ouvre la porte à des comparaisons, à même de souligner les contradictions de l’extractivisme.
Aussi, le tableau qui suit compare les transferts de valeur induits par l’échange écologique inégal avec les montants de l’aide publique au développement (ODA), il s’agit d’une actualisation de cette comparaison que Samir Amin avait déjà proposée[29].

Ce dernier graphique compare les montants du drainage lié à l’échange inégal, exprimés en prix du Nord, en prix mondiaux, avec les montants reçus par le Sud sous forme d’aide publique au développement. L’écart est saisissant : en 2015, les transferts nets par échange inégal dépassaient de plus de 30 fois les montants de l’aide au développement[30].
Il est donc important de noter à ce stade, que la théorie de l’échange écologique inégal s’ancre explicitement dans l’histoire des théorisations de l’impérialisme, en particulier dans le sillage d’une approche structurelle de l’impérialisme telle qu’elle a été développée par Samir Amin. Elle permet même de rendre plus concret le calcul du drainage qu’il a proposé en passant d’abord par des unités physiques. Il y a donc une continuité théorique entre cette théorie très importante dans l’économie écologique contemporaine et la théorie de l’impérialisme.
Cette continuité n’est donc pas que théorique car la démonstration de cet appropriation matérielle et monétaire, nous montre que l’impérialisme dans ses structures matérielles de cet échange écologique inégal. Aussi la lutte contre l’impérialisme amène à thématiser la question écologique à travers ces flux de matière qui sont appropriés par le Nord. “Comment stopper ce pillage matériel et énergétique ?” doit être une question centrale pour les militant·es anti-impérialistes, en particulier dans le Nord Global. De ce point de vue, l’industrie pétrolière est un excellent exemple de cette appropriation et de la destruction environnementale qu’elle sème.
Il est donc indispensable de comprendre les dévastations écologiques comme le résultat de ce processus d’accaparement matériel et énergétique que l’on décrit sous la catégorie d’échange écologique inégal. On a souvent dit que l’écologie était une idéologie du Nord Global, en particulier depuis la phase du mouvement climat, très puissant dans les pays scandinaves. La réponse à cette accusation a de l’autre côté souvent consisté à montrer qu’il existe des mouvements écologistes dans le Sud Global. C’est absolument vrai. Mais d’un point de vue objectif, si l’on prend l’écologie comme un problème planétaire, c’est bien du côté de l’impérialisme en tant que forme de l’accumulation capitaliste à l’échelle planétaire qu’il faut chercher les stratégies d’action. De ce point de vue, le tournant pro-palestinien de Greta Thunberg ou la participation des soulèvements de la terre à la coalition guerre à la guerre dénotent la pertinence théorique et politique de ces rapprochements.
Dans cette dernière partie, nous essaierons d’analyser la phase en gestation dans le Nord Global, en particulier en Europe. La conjoncture étant particulièrement instable, l’exercice est particulièrement ardu : il nous faut analyser la façon dont se réagence actuellement l’extractivisme, en prenant en compte cette volatilité. Nous analyserons les dispositions politiques prises à cet égard, au niveau européen. D’un point de vue théorique, après avoir introduit brièvement la notion d’échange écologique inégal, nous allons évoquer une des idées importante provenant des études sur l’extractivisme, le security sustainability nexus théorisé par Théa Riofrancos[31], c’est-à-dire de l’utilisation du motif écologique pour permettre une sécurité économique, et la fusion de ces deux domaines. Ce nexus securité-durabilité désigne l’articulation stratégique entre la sécurisation des chaînes d’approvisionnement en minerais critiques, notamment le lithium, et les engagements de durabilité écologique et sociale dans le cadre de la transition énergétique. Ce concept met en lumière la tension entre des logiques géopolitiques de contrôle et d’autonomie matérielle — souvent associées à une relocalisation extractive dans le Nord global — et des exigences normatives de justice environnementale. Il souligne ainsi que la quête de sécurité peut instrumentaliser ou diluer les principes de durabilité, révélant les contradictions inhérentes aux politiques techno-industrielles « vertes ».
Nous avons replacé la question de l’extractivisme au sein de l’échange écologique inégal. Cependant, il faut comprendre les spécificités de la situation actuelle de l’extractivisme, et la nouvelle phase d’accumulation qui lui correspond. En effet, les phases de l’histoire du capitalisme se caractérisent notamment par des flux métaboliques différents, c’est-à-dire par différentes organisations politiques, spatiales et temporelles de la circulation de la matière et de l’énergie. Par exemple, la phase néolibérale s’est caractérisée en France par une externalisation quasi-totale de l’extraction en dehors des frontières nationales[32].
Au contraire, la phase qui s’ouvre avec la transition énergétique remet en cause cette régulation des flux de matières puisque l’extraction minérale de nouvelles matières devient indispensable à la nouvelle phase d’accumulation de capital (celle qui s’ouvre notamment avec la transition des véhicules thermiques au véhicules électriques). De plus, le contrôle de technologies clés par des concurrents des Etats-Unis et de l’Europe occidentale – en particulier la Chine qui dispose de chaînes de production intégrées de ces nouvelles technologies – provoque le retour de politiques protectionnistes annoncées par Trump, voire d’une réintégration apparente de l’extraction à l’espace européen.
Avant de commencer, un petit point sur la différence entre métaux “rares”, “critiques”, et “stratégiques”.
– La rareté est un statut géologique : elle indique la faible quantité de ce métal sur Terre.
– La criticité d’un métal dépend quant à elle de deux facteurs : d’une part les propriétés exceptionnelles du métal, et d’autre part les risques que les problèmes d’approvisionnement pourraient faire peser sur des secteurs industriels, voire sur l’économie nationale.
– Enfin, un métal est dit stratégique quand “il est indispensable à la politique d’un État, à sa défense, à sa politique énergétique ou à celle d’un acteur industriel spécifique (exemple : métaux pour la transition énergétique)”[33] – il s’agit donc d’un type particulier de criticité.
Il est important de noter que cette typologie concerne en particulier la France et que nous serons amenés à employer le terme de matières critiques ou de métaux critiques pour aborder cette question, par exemple dans le cadre européen.
La politique européenne : le Critical Raw Material Act
Le cadre légal dans lequel s’insère cette politique en Europe est le Critical Raw Material Act (CRM Act). Le CRM Act est la directive européenne qui explique la relance du secteur minier en France et en Europe. Il est manifeste que cette disposition est une réponse à la politique commerciale américaine qui incite à ne pas exporter les métaux critiques.
L’idée derrière le Critical Raw Material act est que les matières premières critiques sont indispensables à l’économie de l’Union Européenne (UE) dans un ensemble étendu de technologies nécessaires aux secteurs stratégiques : les énergies renouvelables, le numérique, l’espace et – last but not least – la défense. La loi sur les matières premières critiques est supposée garantir à l’UE un accès sécurisé et durable à ces matières premières cruciales, permettant à l’Europe de répondre à ses objectifs climatiques et numériques pour 2030. Cette disposition légale est motivée par le croisement de deux risques :
– Le premier risque invoqué est climatique (en vue de la transition écologique).
– En fait, le risque d’approvisionnement de ces matières premières, du fait de la faible production européenne. En effet, la Chine est l’un des géants du marché mondial du lithium brut, mais aussi d’autres métaux, ainsi que de la production de batteries Li-ion. Ainsi, la Chine risque de privilégier la production sur son sol, et donc ne pas exporter ses matériaux, brisant les chaînes de valeur sur lesquelles l’économie et la production européenne repose.
Dans ce cadre qu’est le marché mondial du lithium, la Commission européenne a proposé ce texte de loi qui se présente comme “une réponse globale à ces défis s’appuiera sur la force du marché unique. Grâce à cette loi, l’UE veillera à disposer de chaînes de valeur solides, résilientes et durables pour les matières premières critiques. La proposition de règlement renforcera l’ensemble des étapes de la chaîne de valeur européenne des matières premières critiques, diversifiera les importations de l’UE pour réduire les dépendances stratégiques, améliorera la capacité de l’UE à surveiller et à atténuer les risques de perturbations dans l’approvisionnement en matières premières critiques, tout en favorisant la circularité et la durabilité.”
Ainsi, les attitudes protectionnistes de contrôle des chaînes d’approvisionnement n’ont pas attendu l’arrivée de Trump. Cette action est décrite par la Commission européenne comme le prolongement du Green Deal Act ainsi que du Net Zero Industry Act[34] visant à faire monter en puissance la production de “technologies stratégiques”. Il est important de souligner que ce ne sont pas seulement les technologies “vertes” qui sont visées, mais aussi le numérique, la défense et le secteur spatial. Parler de capitalisme vert est avant tout idéologique. Toutefois, il faut être sensible au développement de la situation de crise du néo-libéralisme qui ouvre la voie à un autre régime d’accumulation.
En effet, non seulement tout est fait pour poursuivre l’extraction de ressources fossiles mais les technologies décisives de ce cycle ne sont pas avant tout vertes. De ce point de vue, l’écologie de guerre que certains appelaient de leurs vœux est loin de ses prétentions pacifistes originelles[35]. Il laissera selon toute vraisemblance le souvenir d’un populisme ayant pour but d’accélérer le rattachement des franges impérialistes de la gauche à un projet de remilitarisation globale.
Concrètement, le Critical Raw Material Act fixe des critères tout au long de la chaîne de valeur stratégique des matières premières et pour la diversification des approvisionnements de l’UE.
1) Au moins 10 % de la consommation annuelle de l’UE doit être issue de l’UE pour l’extraction.
2) Au moins 40 % de la consommation annuelle de l’UE doit être issue de l’UE pour la transformation.
3) Au moins 15 % de la consommation annuelle de l’UE doit être issue de l’UE pour le recyclage.
4) La consommation annuelle de l’UE en provenance d’un seul pays tiers ne doit pas dépasser 65 %.
De fait, cette loi affiche des objectifs qui sont résolument contradictoires. Il s’agit d’une part de simplifier les procédures de permis d’exploration et d’exploitation des mines, et d’autre part de maintenir de “hauts standards sociaux et environnementaux”. Il s’agit en particulier de réduire les délais d’obtention de ces permis pour les sociétés minières. On peut noter qu’en France, la loi de “simplification de la vie économique” a le même but, c’est-à-dire de faciliter l’implantation de projets en passant outre le débat public.
La loi instaure un système de surveillance pour suivre la chaîne d’approvisionnement en matières premières essentielles et effectuer des tests de résistance. Elle coordonne également la constitution de réserves stratégiques et impose des obligations de préparation aux risques aux grandes entreprises impliquées dans la production de technologies stratégiques.
Les pays membres de l’Union Européenne s’engagent à améliorer la collecte des déchets contenant des matières premières essentielles et à garantir leur recyclage en matières premières secondaires critiques. Ils devront également examiner, en collaboration avec les acteurs privés, le potentiel de récupération des matières premières critiques à partir des déchets issus de l’extraction. Pour promouvoir le recyclage à grande échelle des aimants permanents, la législation énonce des critères de recyclabilité et de contenu recyclé. De plus, elle donne à la Commission le pouvoir d’établir des normes concernant l’empreinte environnementale des matières premières critiques soumises à diverses garanties. Ces mesures sont supposées contribuer à augmenter la circularité et la durabilité des matières premières critiques sur le marché de l’UE, permettant ainsi aux consommateurs de faire des choix éclairés concernant les produits contenant ces matières premières. En ce qui concerne le lithium, on peut largement douter de l’efficacité de telles mesures dans la mesure où le recyclage de cet élément chimique n’existe pas à l’heure actuelle dans aucun États membre de l’Union européenne, dans la mesure où la quasi-totalité des capacités de recyclage industriel sont situées en Chine.
Le commerce international joue un rôle crucial dans le soutien à la production mondiale et dans la garantie de la diversification de l’offre. Les initiatives de l’Union Européenne consistent à :
1) Établir un « club » de matières premières critiques ouvert à tous les pays intéressés pour renforcer les chaînes d’approvisionnement mondiales.
2) Utiliser les accords commerciaux pour sécuriser et élargir le commerce des matières premières critiques.
3) Élargir le réseau de partenariats stratégiques de l’UE en adoptant une approche axée sur la chaîne de valeur et une forte dimension de durabilité.
4) Exploiter la passerelle mondiale pour mettre en place des infrastructures flexibles et robustes afin de soutenir le déploiement de projets tout au long de la chaîne de valeur des matières premières et favoriser la connectivité.
5) Collaborer avec les pays membres de l’UE pour établir une facilité de crédit à l’exportation de l’UE afin de réduire les risques liés aux investissements à l’étranger.
6) Combattre les pratiques commerciales déloyales liées aux matières premières et renforcer l’application de la législation.
Pour assurer une coordination globale, le projet propose la création d’un Comité européen des matières premières critiques, composé de pays membres de l’UE et de la Commission, chargé de conseiller et de coordonner la mise en œuvre des mesures énoncées dans le projet et de discuter des partenariats stratégiques de l’UE avec les pays tiers.
Le CRM act est clairement lié aux tensions géopolitiques croissantes et plus généralement à la disruption multifactorielle des chaînes de production, qu’il s’agisse des perturbations liées à des problèmes climatiques, à des intempéries climatiques ou à des conflits géopolitiques. Actuellement, en l’occurrence, l’approvisionnement en matière première minérale est perturbé par l’invasion de l’Ukraine par la Russie et par les affrontements intenses dans la région du Donbass, haut lieu minier en Europe, mais aussi par d’autres conflits comme le blocus houthi du détroit de Bab-el-Mandeb. C’est la raison pour laquelle ce texte de loi a été présenté par Van der Leyen lors de son discours de 2022 sur l’état de l’Union.
En fait, la question des mines est posée uniquement du point de vue de la politique extérieure : il s’agit pour l’Union de développer le secteur extractif à l’extérieur de ses frontières, en particulier en Afrique :
« L’activité minière durable peut et devrait contribuer au développement durable. De nombreux pays en développement – en particulier en Afrique – ne sont cependant pas parvenus à mettre les ressources dont ils regorgent au service d’une croissance durable et inclusive, souvent en raison de problèmes de gouvernance liés aux cadres réglementaires ou à la fiscalité. Améliorer la gouvernance et la transparence, de même que le climat des échanges et des investissements dans le secteur des matières premières est essentiel pour atteindre une croissance inclusive et un développement durable dans les pays riches en ressources. Grâce à ses politiques de développement et en partenariat avec les pays en développement, l’UE peut jouer un rôle crucial à cet égard, en créant des situations profitables à tous dans lesquelles pays développés et pays en développement jouissent d’une offre durable en matières premières et en mettant les ressources financières intérieures tirées du secteur minier au service du développement durable pour soutenir les objectifs de stratégies visant la croissance inclusive et la lutte contre la pauvreté.”[36].
Le texte de 2022 ne fait pas que combiner le verdissement de l’économie et de sa réorganisation pour faire face à des conflits géopolitiques majeurs, les deux sont absolument indissociables. C’est la raison pour laquelle, au-delà des enjeux d’accès aux matières premières, ce texte fait partie du Green Deal Industrial Plan.
Le Green Deal Industrial Plan est avant tout un plan d’investissement dans le secteur des technologies énergétiques propres qui s’ancre dans une phase de conflits énergétiques en résurgence : “L’UE a également montré comment la transition verte peut renforcer la compétitivité. L’abandon progressif des combustibles fossiles russes a accéléré une nouvelle révolution industrielle visant à mettre fin à l’ère des combustibles fossiles. Un large éventail de nouvelles technologies nettes zéro est en cours de développement et de déploiement dans l’ensemble de notre économie : dans les transports, les bâtiments, l’industrie manufacturière, l’énergie, et même en créant des marchés entièrement nouveaux. Notre écosystème net-zéro représentait plus de 100 milliards d’euros en 2021, soit un doublement de la valeur depuis 2020.”
CONCLUSION
Dans cette conjecture, les fronts de luttes écologistes et anti-impérialistes se relient donc plus que jamais. Cependant comme l’a déjà souligné Martin Arboleda dans son livre Planetary Mine, il est indispensable de sortir du nationalisme méthodologique pour étudier les mines, et nous ajouterions, aussi des approches exclusivement locales pour lutter contre l’exploitation de ces ressources par les oligopoles capitalistes et leur absorption dans le secteur de l’armement.
Sans perspective anti-impérialiste, même les luttes anti-extractives les plus déterminées sont impuissantes car du point de vue des capitalistes, elles ne font que baisser l’avantage comparatif d’une mine sur une autre. Il faut donc remettre au centre la question du contrôle populaire de la structure de l’économie. L’une des perspectives pour cela serait de créer des alliances le long des chaînes de valeur globales tout en se concentrant sur les secteurs critiques que Lénine appelait les « hauteurs stratégiques » de l’économie[37].
Ainsi pour Lénine, il ne s’agit pas de contrôler immédiatement tout l’appareil industriel russe puis soviétique, mais de parvenir à ce contrôle au travers de l’électrification. D’où le slogan “Socialisme = Soviets + Electricité” ! Plus qu’un mythe progressiste, même ce slogan en relève indéniablement déniablement, il s’agit de penser non seulement la prise du pouvoir politique mais aussi le contrôle sur le métabolisme – ici énergétique. Comme le rappelle Toni Negri commentant ce mot d’ordre : “il ne peut y avoir de révolution sociale sans une base matérielle adéquate susceptible de la soutenir. Ce qui signifie que toute proposition politique qui vise à la subversion du système capitaliste, de sa figure politique et du mode de vie existant, si elle n’est pas en même temps porteuse d’un projet de transformation du mode de production adéquat, est faussement révolutionnaire.”[38].
Les problèmes de transformation de la base matérielle et énergétique sont beaucoup plus complexes car imbriqués mondialement et avec des variables à prendre en compte, immense, à la mesure de l’ordre des crises planétaires. Cependant, nos capacités en termes statistiques et computationnelles sont incommensurables à celle de la période de la révolution russe et celle du Plan d’État pour l’électrification de la Russie. Le problème est donc celui des coalitions ou alliances prêtes à mobiliser ces formes de savoir qui dépassent le niveau local pour développer une planification qui soit à la fois une science de la destruction du mode de production capitaliste mais aussi le moteur de la socialisation. Il est aussi très important de saisir où se trouvent ces goulets d’étranglement que ce soit dans un entrepôt logistique ou dans le détroit de Bab-el-Mandeb pour construire nos stratégies au-delà des effets de surface.
Notes
[1] Alberto Acosta. “Extractivism and neoextractivism: two sides of the same curse”. Beyond Development, 2013, p. 61. ⤴️
[2] Celia Izoard. La ruée minière au XXIe siècle. Paris, Éditions de La Découverte, 2022. ⤴️
[3] Samir Amin. L’Eurocentrisme. Paris, Anthropos, 1988. ⤴️
[4] Jean-Baptiste Fressoz. Sans transition. Une nouvelle histoire de l’énergie. Paris, Seuil, 2023. ⤴️
[5] CNUCED, State of Commodity Dependence, 2021. ⤴️
[7] David Ricardo. Des principes de l’économie politique et de l’impôt, trad. fr., Paris, GF Flammarion, 1992 [1817], chap. II. ⤴️
[8] Le coût d’opportunité correspond à la valeur de ce à quoi on renonce en choisissant une option plutôt qu’une autre. ⤴️
[9] “The Dutch Disease”. The Economist, 26 novembre 1977. ⤴️
[10] Jagdish Bhagwati. “Immiserizing Growth: A Geometrical Note”. The Review of Economic Studies, vol. 25, no 3, 1958, p. 201–205. ⤴️
[11] Alfredo Saad-Filho et John Weeks. “Curses, Diseases and Other Resource Confusions”. The Journal of International Development, vol. 25, no 8, 2013, p. 1123–1138. ⤴️
[12] Rosa Luxemburg. L’Accumulation du capital. Marseille, Agone, 2019 [1913], chap. 31. ⤴️
[13] Léon Trotsky. Histoire de la Révolution russe. Paris, Éditions du Seuil, 1963. Vol. 1, chap. 1. ⤴️
[14] Ernest Mandel. Le Troisième âge du capitalisme. Paris, 10/18, 1972, chap. 3. ⤴️
[15] Jason Hickel, Dylan Sullivan, Huzaifa Zoomkawala. “Plunder in the Post-Colonial Era: Quantifying Drain from the Global South Through Unequal Exchange, 1960–2018”. New Political Economy, vol. 26, no 6, 2021, p. 1030–1047. ⤴️
[16] Arghiri Emmanuel cité dans Christian Palloix. “Impérialisme et commerce international”. L’Homme et la Société, no 12, 1969. ⤴️
[17] Günter Köhler. “Estimating Unequal Exchange: Sub-Saharan Africa to the World”. Springer Books, 2023, p. 297–315. ⤴️
[18] Article de Kohler ⤴️
[19] Samir Amin. Le Développement inégal. Paris, Éditions de Minuit, 1973, chap. « De la spécialisation à la dépendance ». ⤴️
[20] István Mészáros. “The Only Viable Economy”. Monthly Review, vol. 58, no 11, avril 2007. https://monthlyreview.org/2007/04/01/the-only-viable-economy/ ⤴️
[21] Karl Marx. Le Capital, Livre I, chap. 7, section 1. Paris, Éditions sociales, 1983. ⤴️
[22] István Mészáros. The Challenge and Burden of Historical Time. New York, Monthly Review Press, 2008. ⤴️
[23] Karl Marx. Le Capital, Livre II, 3e section, chap. XIII. Paris, Éditions sociales, 1983. ⤴️
[24] Samir Amin. Le Développement inégal. Paris, Éditions de Minuit, 1973. ⤴️
[25] Wiedmann, Thomas et al. “The material footprint of nations”. Nature Communications, 2015. ⤴️
[26] Bruckner, Martin et al. “Global multidimensional poverty and resource use”. Ecological Economics, 2015. ⤴️
[27] Chen, Zhe George et al. “The energy footprint of global supply chains”. Nature Communications, 2018. ⤴️
[28] Alsamawi, Omar et al. “The inequality footprints of nations”. Journal of Industrial Ecology, 2014. ⤴️
[29] OCDE. Données sur les salaires moyens, 2015. ⤴️
[30] Voir encore Amin, Le Développement inégal, chap. « De la spécialisation à la dépendance ». ⤴️
[31] Thea Riofrancos. “The Security–Sustainability Nexus: Lithium Onshoring in the Global North”. Global Environmental Politics, vol. 23, no 1, 2023, p. 20–41. ⤴️
[32] Louison Cahen-Fourot, Cédric Durand. “La transformation de la relation sociale à l’énergie du fordisme au capitalisme néolibéral”. Revue de la régulation, no 20, 2016. ⤴️
[33] Mineral Info, 2022. Substances critiques et stratégiques. https://www.mineralinfo.fr/fr/securite-des-approvisionnements-pour-leconomie/substances-critiques-strategiques ⤴️
[35] Pierre Charbonnier. Vers l’écologie de guerre. Une histoire environnementale de la paix. Paris, Éditions La Découverte, 2024. ⤴️
[36] CRM Act, 2022. ⤴️
[37] Lénine. “La catastrophe imminente et les moyens de la conjurer”. Septembre 1917. ⤴️
[38] Toni Negri. “Socialisme = Soviets + Electricité”. Revue Période, septembre 2017. ⤴️
Sommaire
- LIMITES DE LA THEORIE CLASSIQUE
- A. L’approche de l’économie classique.
- B. Les problèmes de l’extractivisme selon la théorie classique.
- IMPERIALISME ET EXTRACTIVISME
- – Le développement inégal et combiné.
- FONDEMENTS DE L’ECHANGE ECOLOGIQUE INEGAL
- A. L’échange inégal.
- B. La rupture métabolique.
- L’ECHANGE ECOLOGIQUE INEGAL
- CRITICITE, GUERRE ET DECARBONATION : UN NOUVEL EXTRACTIVISME ?
- – La politique européenne : le Critical Raw Material Act.
- CONCLUSION
Corpus
Voici un ensemble de textes pour vous permettre d’aller plus loin sur ce sujet
- L’extractivisme « progressiste » existe-t-il ? – Patrick Guillaudat
- Revue Contretemps
- A bas la mine ou à bas l’Etat ? – Maëlle Mariette & Franck Poupeau
- Le Monde Diplomatique
- Digging Free of Poverty – Thea Riofrancos
- Jacobin
Partager

Comprendre les rapports de domination a l’echelle internationale
Notre groupe de lecture propose un espace d’auto-formation où nous explorons collectivement les enjeux de l’anti-impérialisme et ses résonances dans les luttes contemporaines, de l’écologie à l’antiracisme. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes et accessibles, ouvertes à toutes et tous, dans une dynamique d’échange et de partage des savoirs.
Comprendre les rapports de domination à l’échelle internationale

Notre groupe de lecture propose un espace d’auto-formation où nous explorons collectivement les enjeux de l’anti-impérialisme et ses résonances dans les luttes contemporaines, de l’écologie à l’antiracisme. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes et accessibles, ouvertes à toutes et tous, dans une dynamique d’échange et de partage des savoirs.