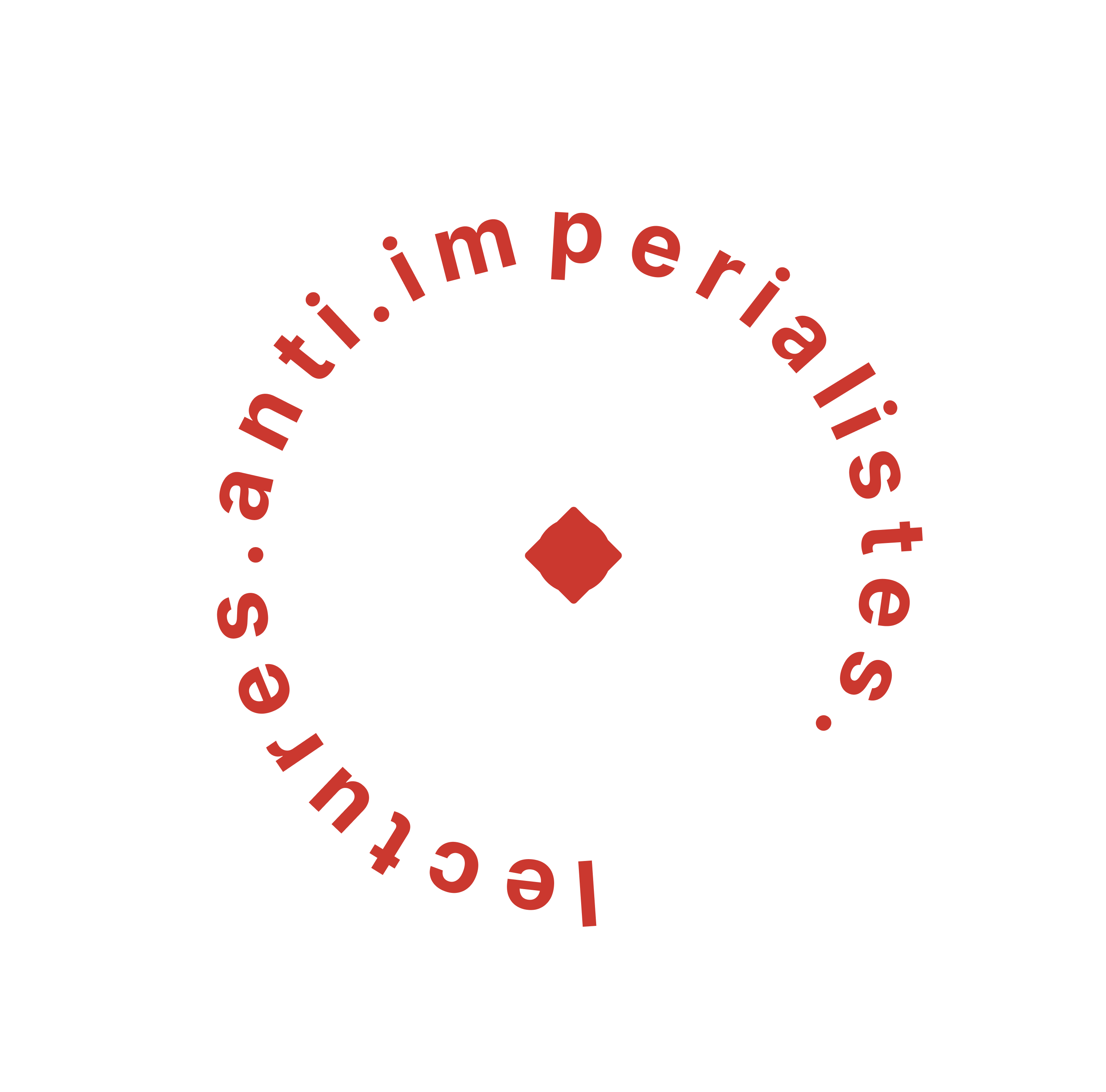Le Souverain et le Marché, Histoire et théorie de l’impérialisme classique
Benjamin Bürbaumer
Dans son livre Le Souverain et le Marché, Benjamin Bürbaumer s’est attelé à dresser une généalogie des théories de l’impérialisme, des origines à nos jours. Son premier chapître s’intéresse plus spécifiquement au contexte historique d’émergence de l’impérialisme classique, dans le sillage duquel apparaissent les premières théories qui cherchent à décrire le phénomène et à en saisir les contours.
Texte tiré du premier chapitre de l’ouvrage de Benjamin Bürbaumer : Le Souverain et le Marché : Théories Contemporaines de I’Impérialisme (2020), reproduit avec l’aimable autorisation des éditions Amsterdam.
Chapitre 1 : Histoire et théorie de l’impérialisme classique
Mû par la nécessité systémique de l’accumulation illimitée du capital, le capitalisme s’est étendu de l’Europe de l’Ouest au monde entier en un siècle à peine [01]. En conséquence, la compréhension de l’évolution concomitante du système international passe par celle de la tendance à l’expansion inhérente au fonctionnement de ce mode de production – expansion qu’on assimilerait à tort à un développement paisible du marché mondial, le commerce ne rendant pas la guerre obsolète, contrairement à ce qu’a pu en dire la tradition libérale. La violence physique a en effet joué un rôle décisif à la fois dans l’avènement du capitalisme et dans son extension continue depuis le XvIIIe siècle. C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre l’émergence de tentatives visant à proposer une théorie de l’impérialisme : envisageant le capitalisme comme une totalité, celles-ci mettent précisément l’accent sur les interactions observables à l’échelle mondiale entre violence physique et développement économique. D’où il suit que l’analyse de l’économie politique internationale des grandes puissances modernes, et notamment de leur recours à la guerre, se situe au cœur des théories de l’impérialisme.
Des fondements violents
Corollaire de la propriété privée des moyens de production – le trait fondamental du capitalisme –, le mécanisme de la concurrence conditionne l’existence de chaque entreprise à la réalisation d’investissements toujours croissants. Il en découle un processus illimité d’accumulation du capital que Marx a résumé d’un adage désormais célèbre : « Accumulez, accumulez ! C’est la loi et les prophètes ! » L’émergence de cet impératif d’accumulation, inconnu des sociétés antérieures, transforme chaque pays en autant de débouchés potentiels pour la production, de sources de matières premières et de cibles d’investissements. En tant qu’intermédiaires elle place les États eux-mêmes en position de rivalité sur le terrain économique, rivalité toujours susceptible d’évoluer vers le conflit armé.
Un tel schéma ne doit cependant pas conduire à mettre de côté la dimension intrinsèquement violente du capitalisme, et ce dès sa genèse. D’une part, l’émergence de la figure du travailleur libre – celui dont la force de travail est une marchandise, et la seule qu’il ait à vendre – a pour condition l’expropriation de la population rurale identifiée notamment au mouvement des enclosures, laquelle a nécessité un recours évident à la violence physique.
D’autre part, le capitalisme agraire de l’Angleterre du XVIIe siècle est lui-même le produit d’une configuration politique certes particulière, mais tributaire d’un contexte plus large : aux XvIe et XVIIe siècles, la lutte pour l’hégémonie en Europe oppose l’Empire autrichien à l’Empire ottoman. Les tentatives d’élargissement de l’Empire ottoman – le blocage des routes commerciales vers l’Asie – et les conquêtes en Europe du Sud-Est réduisant la menace impériale des Habsbourg sur le continent européen ont éloigné des îles britanniques le centre de gravité de la politique européenne, et donc aussi la menace d’invasion et de guerre. Ceci a permis à la classe dominante locale de développer en nouveau système d’appropriation de plus-value mis en œuvre avec les enclosures et une nouvelle division sexuée du travail [02]. Mais ce développement domestique ne suffit pas à comprendre la transition de l’Angleterre vers un capitalisme de type industriel. Seule la conjonction d’un ensemble de facteurs – la possession des terres américaines, le travail des esclaves africains et l’existence de capitaux anglais en quantité suffisante – y a permis le dépassement des limites du capitalisme agraire [03].
L’Atlantique a donc joué un rôle déterminant dans la genèse du capitalisme industriel. Cette dimension internationale de l’accumulation primitive était déjà soulignée par Marx : « La découverte des contrées aurifères et argentifères de l’Amérique, la réduction des indigènes en esclavage, leur enfouissement dans les mines ou leur extermination, les commencements de conquête et de pillage aux Indes orientales, la transformation de l’Afrique en une sorte de garenne commerciale pour la chasse aux peaux noires, voilà les procédés idylliques d’accumulation primitive qui signalent l’ère capitaliste à son aurore [04].» En d’autres termes, l’émergence du capitalisme industriel a pour condition, outre l’expropriation des paysans anglais et la distinction entre production et reproduction, le processus violent par lequel furent institués la traite atlantique et l’esclavage ainsi que l’accaparement des ressources naturelles américaines, notamment les terres et métaux précieux. Sans le déploiement d’une telle violence, l’Europe n’aurait probablement pas connu une concentration des capitaux d’un niveau analogue à celui observé à partir du XVIIe siècle – le rôle joué par la périphérie dans ce mouvement de concentration est d’ailleurs plus important encore au XIXe, nous y reviendrons.
Le développement international
du capitalisme
À partir du XvIIIe siècle, l’économie capitaliste est bien établie en Angleterre et se développe au nord-ouest de l’Europe. Les révolutions française et anglaise introduisent une nouvelle forme politique, la démocratie libérale – même s’il importe de souligner que cette forme politique ne concerne alors que l’espace domestique, et qu’elle n’a en outre pas « naturellement » conduit à l’octroi de droits politiques et sociaux à la classe ouvrière naissante, qui a dû lutter pour les obtenir. En effet, la France et l’Angleterre continuent alors leur conquête respective d’un vaste empire colonial, et en consolidant son pouvoir en Inde, cette dernière parvient à asseoir sa position hégémonique à l’échelle mondiale. Toutefois, l’industrialisation de l’Europe confère une place plus centrale au commerce et relègue le pillage du monde non occidental à un rôle secondaire du point de vue de la dynamique d’accumulation [05].
Cette nouvelle situation ne modifie pas pour autant les relations d’échanges profondément asymétriques entre les mondes capitaliste et non capitaliste. En effet, l’industrialisation de son secteur du textile a permis à la Grande-Bretagne de fabriquer pour la première fois un bien très compétitif à destinations des marchés asiatiques. Rétrospectivement, cette évolution représente le premier pas vers une division du travail à l’échelle internationale qui s’est avérée durablement défavorable aux pays du Sud. Tandis que ces derniers exportent des matières premières et des produits agricoles dont le prix tendent à baisser, le monde industrialisé leur vend des biens manufacturés dont le prix augmente. Malgré ses avancées en matière d’industrialisation, l’Angleterre a entouré son industrie du textile par des mesures protectionnistes tout en imposant à l’Inde une politique de libre-échange, la même qu’elle impose plus tard à la Chine au moyen des Guerres de l’opium. C’est seulement à partir des années 1830, au moment où est avérée la supériorité de son industrie textile domestique, que la Couronne commence à défendre le libre-échange de manière indiscriminée. Et encore faut- il attendre l’abrogation des Corn Laws en 1846 – des lois protégeant la production agricole anglaise – pour qu’elle mette véritablement en cohérence son discours et sa politique économique.
Au cours de cette période, à mesure que les regroupements d’entreprises à l’échelle nationale affaiblissent la pression concurrentielle, un excédent de capital commence à se manifester dans les pays industrialisés. Dans un premier temps, cet excédent est investi dans des secteurs encore peu touchés par ce phénomène, étendant ainsi le mouvement de concentration des capitaux. Mais le développement de la monopolisation provoque une situation où il est toujours plus difficile de trouver des investissements rentables à l’échelle nationale [06]. En réaction, les entreprises occidentales se tournent donc vers les colonies et semi-colonies – des pays formellement indépendants mais économiquement peu développés en Amérique latine et en Europe de l’Est –, en y augmentant leurs investissements. Les avancées technologiques, notamment dans les domaines de la communication et des transports (chemins de fer, télégraphie, bateaux à vapeur, mécanisation de l’agriculture), ont facilité ce tournant, qui a nourri en retour la tendance à la baisse du taux de profit dans les pays les plus développés [07]. Si l’appropriation de plus-value à des niveaux élevés dans les pays périphériques a d’abord eu pour effet de contrecarrer cette baisse, l’exportation de capitaux vers le monde extra-capitaliste n’y a pas remplacé l’exportation de marchandises : au contraire, les deux sont révélés complémentaires. À cet égard les mots de Jules Ferry sont révélateurs. Il identifiait la conquête de la Chine à celle de 400 millions de consommateurs pour les producteurs européens [08]. Et de fait, les crédits que certains pays périphériques se sont vus attribuer ont, pour une part, servi à absorber la production des métropoles.
Longtemps, l’Angleterre fut le seul pays à exporter du capital. Elle fut rejointe par la France au cours des années 1870 et, une décennie plus tard, par l’Allemagne et les États-Unis, ce mouvement conduisant à l’intensification de la compétition entre les pays capitalistes [09]. Sous la pression concurrentielle exercée par l’impératif de l’accumulation du capital, les États-Unis et l’Allemagne deviennent rapidement des puissances de premier ordre. Ce phénomène, plus tard théorisé sous le terme de « développement inégal et combiné » du capitalisme, repose sur la dynamique selon laquelle « les sauvages renoncent à l’arc et aux flèches, pour prendre aussitôt le fusil, sans parcourir la distance qui séparait, dans le passé, ces différentes armes [10]». Autrement dit, si l’Allemagne et les États-Unis ont pu rattraper l’Angleterre en relativement peu de temps, c’est précisément car leur retard en termes de développement capitaliste leur a évité d’avoir à en parcourir toutes les étapes parcourues par l’Angleterre. Ces pays « arriérés [11]» pouvaient se développer en « bénéficiant » des influences, pressions et leçons du pays le plus avancé et ainsi adopter les institutions, pratiques et technologies les plus récentes [12].
Au passage de la brève période dite du « libre-échange », qu’inaugure le traité franco-anglais de 1860, à celle de l’« impérialisme classique », qui s’ouvre avec l’introduction de nouveaux droits de douane en Autriche-Hongrie en 1878, correspond une profonde transformation des rapports de production et d’échange entre les métropoles et la périphérie : aux exportations de marchandises par les puissances métropolitaines s’ajoutent celles de capitaux, qui atteindront un volume autrement plus conséquent. Ces dernières exposent les entreprises de la métropole à un risque plus important, dans la mesure où il ne s’agit plus seulement pour elles de s’assurer le paiement de factures mais de garantir un certain niveau de rendements. Cela implique de protéger les terres et les ressources à la fois contre les populations locales et la concurrence étrangère. Là où les classes dominantes locales contrôlaient auparavant la production et l’exportation de matières premières, elles se trouvent désormais soumises aux exigences des classes dominantes des métropoles. Celles-ci introduisent dans la périphérie un capitalisme peu intense en capital reposant sur une force de travail tellement bon marché que l’emploi de machines à grande échelle n’y est pas rentable, freinant ainsi tout développement économique qui passerait par une augmentation de la productivité. Plus précisément, les faibles coûts de main-d’œuvre et l’absence d’incitation à l’introduction de machines modernes ont « créé un écart croissant des niveaux respectifs de productivité, qui à la que la classe ouvrière. Or, ils sont plus avancés en termes de possession du pouvoir » (How the West Came to Rule, op. cit., p. 56). fois exprimait et perpétuait le sous-développment réel [13].». Dès lors, le développement économique de la périphérie s’est trouvé lié à celui des métropoles.
L’ampleur des mesures protectionnistes et la compétition entre les pays industrialisés s’accentuent fortement entre 1878 et 1914. L’Allemagne suit en 1879 le mouvement initié un an plus tôt par l’Autriche-Hongrie, avant que le protectionnisme ne se généralise aux principaux pays industrialisés. Cette évolution est accompagnée par un regain du colonialisme et la mise en place de relations économiques privilégiées entre les puissances coloniales européennes et leurs colonies, si bien qu’au début du XXe siècle le monde entier – à l’exception de l’Antarctique – est divisé en autant de sphères d’influence qu’il y a de grandes puissances. L’historien de l’économie Paul Bairoch, qui a certes nuancé le rôle des matières premières fournies par la périphérie dans l’industrialisation occidentale, n’en souligne pas moins l’importance des exportations des produits miniers comme le cuivre, l’étain mais aussi d’autres marchandises comme le caoutchouc, les engrais agricoles, le sucre et les textiles au début du XXe siècle. Et l’adoption de la perspective des pays périphériques met en lumière un aspect souvent passé sous silence des flux commerciaux de l’époque : « près de 100 % des matières premières produites dans la plupart des pays du tiers-monde étaient exportées vers les pays développés [14].» L’étude de l’ampleur de la contribution des débouchés périphériques au développement industriel des métropoles menée par Bairoch montre par ailleurs qu’entre 1909 et 1911, 21 % des exportations européennes étaient dirigées vers la périphérie – et en ce qui concerne l’Angleterre, ce chiffre s’élève à 40 % de 1800 à 1938 [15]. Il faut certes relativiser la place des débouchés coloniaux dans le développement économique de l’Europe de l’Ouest, dans la mesure où la part du total des exportations dans le produit national brut était alors moins importante qu’elle ne l’est aujourd’hui. Toutefois, Bairoch rappelle qu’il « est évident que l’accès à un débouché supplémentaire, même marginal, peut avoir une influence non négligeable sur la rentabilité d’un secteur industriel [16].» Et l’importance de tels débouchés conduit l’historien à affirmer que « c’est […] la colonisation européenne moderne, qui s’explique en grande partie par la révolution industrielle [17]».
À la fin du XIXe siècle, 93 % de l’Afrique et une grande part de l’Asie se trouvaient assujetties aux puissances coloniales – l’Angleterre, la France, l’Allemagne, la Belgique, le Portugal, les États-Unis et l’Espagne [18]. Les conflits secondaires qui éclatent alors entre ces dernières sont la traduction des tensions ssues du processus d’accumulation de l’époque dans un langage plus directement politique : la crise de Fachoda de 1898 oppose l’Angleterre et la France au Soudan ; les crises marocaines de 1905 et de 1911 opposent la France et l’Allemagne pour le contrôle de ce pays et mènent à des tensions autour de l’Afrique équatoriale française ; la Russie et l’Autriche-Hongrie se disputent le contrôle des Balkans ; l’Amérique latine s’éloigne du contrôle britannique et passe graduellement sous la domination des États-Unis, sous l’égide de la doctrine Monroe ; le Japon et la Russie entrent en guerre pour la Mandchourie en 1904-1905 ; et les investissements allemands dans les infrastructures du Proche Orient y mettent en cause la domination britannique.
Le discours public sur la politique
d’expansion
En tant que période historique, l’impérialisme classique se caractérise en outre par l’importance du soutien populaire que les gouvernements des grandes puissances parviennent alors à obtenir, notamment du fait de la mise en avant d’un engagement « désintéressé » visant notamment à promouvoir « la civilisation » ou le christianisme. À titre d’exemple, le président américain William McKinley affirme en 1899 que l’objectif de la colonisation américaine est « d’éduquer les Philippins, de les élever, de les civiliser et de les christianiser [19]». À côté de ce type de mise en avant d’une mission civilisatrice, l’époque est au fleurissement des discours patriotiques vantant la gloire desdites grandes puissances, dans un contexte marqué par l’accroissement des transactions menées par les entreprises occidentales par-delà les frontières de leurs métropoles respectives et par l’accentuation concomitante des rivalités économiques sur la scène internationale. Pour la Grande-Bretagne, cette situation correspond concrètement à la mise en cause de son hégémonie. En réaction, elle initie un tournant en matière de politique étrangère, qui a été qualifié de « nouvelle phase d’impérialisme [20]». Au gouvernement depuis 1866, Disraeli met fin aux politiques inspirées par la vision proposée par Richard Cobden d’un âge d’or associant la paix au libre-échange. Il considère au contraire que la Grande-Bretagne a besoin de renforcer son statut de grande puissance, ce également afin de renforcer le socle d’une unité nationale alors défiée par le mouvement ouvrier et des révoltes dans les colonies. C’est la naissance du concept d’« impérialisme social », que résume la formule de l’entrepreneur Cecil Rhodes : « Si vous voulez éviter la guerre civile, il vous faut être impérialiste [21]. » Il s’agit pour les puissances impérialistes à la fois de répondre aux besoins économiques croissants des entreprises et de juguler l’accroissement de la capacité des dominés à se révolter induite par le processus d’industrialisation. L’expédition punitive britannique menée en Éthiopie en 1868 représente l’une des premières mises en œuvre de cette vision.
S’il est alors bien question d’un âge d’or, celui-ci concerne avant tout les idéologies nationalistes, nourries par le lien entre sentiment de fierté nationale et dynamique d’expansion impérialiste. Le roman Greater Britain de Charles Dilke, bestseller immédiat paru en 1868, annonce par exemple le déclin à venir de la Grande-Bretagne si celle-ci ne réalise pas la « nécessité de gouverner et d’éduquer les habitants d’un si grand empire », et estime que « la possession de l’Inde [lui offre un] élément de grandeur de pensée et d’intentions nobles ». La presse britannique de l’époque se fait par ailleurs le relais d’une vision du monde clairement structurée par l’opposition entre la « civilisation » et la « barbarie ». Un indicateur du succès des politiques impérialistes dans l’opinion est l’adhésion de la classe ouvrière britannique à ces dernières. Elles y provoquent un regain d’enthousiasme en faveur de l’Empire qu’elles suscitent. Cet enthousiasme s’exprime notamment dans la fondation d’associations ouvrières en faveur des politiques coloniales, même s’il faut souligner que l’impérialisme a surtout été populaire chez les « cols blancs » et moins chez les ouvriers. Une ambiance similaire règne à Paris à la fin du XIXe siècle : à côté de la tour Eiffel, les citadins et autres touristes se pressent pour admirer les pavillons coloniaux. Harcourt résume ainsi l’air du temps : « la guerre pouvait être la cause nationale qui lierait les classes dans un but patriotique commun ; la guerre détendrait des tensions domestiques en les dirigeant vers l’extérieur où elles ne pourraient pas faire de mal ; et la guerre donnerait à la classe dominante la possibilité de remplir son rôle historique de leader [22]. »
Une telle « fièvre coloniale », capable de canaliser les tensions sociales domestiques en redirigeant les aspirations collectives vers la conquête du monde, s’observe également en Allemagne, où elle se trouve articulée au racisme présent au sein du mouvement ouvrier. Des dirigeants du Parti social-démocrate comme August Bebel et Eduard Bernstein, fortement influencés par la distinction hégélienne entre peuples historiques et peuples sans histoire, ont par exemple défendu un « colonialisme humain [23] ». Cela n’est d’ailleurs pas sans lien avec l’opinion de Bernstein, qui croyait erronée la thèse selon laquelle le capitalisme devrait nécessairement produire des crises et considérait que le développement du capitalisme conduirait à l’amélioration graduelle des conditions de travail et de vie des prolétaires : dans cette optique, il lui était difficile d’envisager l’impérialisme comme une réponse aux contradictions inhérentes à ce développement. Impérialisme et colonisation devaient donc exprimer la marche du progrès, dans la mesure où « chaque race vigoureuse et chaque économie solide, en combinaison avec sa superstructure culturelle, aspire à l’expansion [24] » – même s’il convient de rappeler que les politiques expansionnistes de l’Allemagne n’en ont pas pour autant été mises en œuvre par le mouvement ouvrier. Une autre particularité allemande de l’époque est l’Englandhass ou anglophobie, qui présentait l’avantage de permettre le ciblage direct de la politique d’une puissance rivale, tout en laissant s’exprimer des sentiments anticapitalistes contre la puissance capitaliste par excellence. Dans un contexte marqué par des difficultés économiques et sociales, l’instrumentalisation possible d’une telle mentalité est résumée dans une formule du Chancelier von Bülow : « Seule une politique étrangère réussie peut aider, réconcilier, apaiser et unifier [25]. » Et en effet, l’impérialisme social permettait à la fois de contrôler les dynamiques inhérentes à la société industrielle et de maintenir le statu quo politique.
Certes, les discours attachés à l’impérialisme social variaient d’un pays à l’autre. La haine des Anglais en Allemagne diffère sensiblement de la distinction très ferme promue en Grande-Bretagne entre les colonisateurs et des colonisés frappés de « non-Englishness », laquelle contrastait formellement avec la revendication française d’une certaine égalité – même si cette dernière devait être aussitôt « dissolue dans la domination [26] ». Dans la France de la fin du XIXe siècle, le principal bloc proimpérialiste était réuni autour de l’Union républicaine de Léon Gambetta et de la Gauche républicaine de Jules Ferry. Mais l’enthousiasme pour la colonisation n’épargnait pas des dirigeants socialistes comme Jean Jaurès. En France comme au sein de la IIe Internationale, ce dernier défendait une gestion plus humaine des colonies plutôt que leur destruction, et il pouvait justifier la politique française à Fachoda – s’opposant ainsi aux positions explicitement anti-impérialistes de Jules Guesde [27]. Par ailleurs, il faut remarquer avec l’historien Eric Hobsbawm que globalement, la popularité des politiques impérialistes semble avoir rendu accessoire le fait de les justifier : « à partir du moment où le statut de grande puissance a été associé au fait d’ériger son drapeau sur une plage avec des palmiers […] l’acquisition des colonies elles-mêmes est devenue un symbole de statut [28]. » Remarque que vient corroborer un coup d’œil rapide sur la production scientifique de l’époque : les relations internationales ne devaient voir le jour qu’après la Première Guerre mondiale, tandis que l’économie néoclassique s’est tout à fait désintéressée du phénomène ; quant aux approches de l’économie internationale alors en vigueur, elles insistaient surtout sur l’élimination des barrières à l’échange et cherchaient à déterminer théoriquement les variations des taux de change sous des conditions de concurrence pure et parfaite supposant une forme d’harmonie internationale [29].
Pour terminer ce bref survol, il faut enfin souligner qu’en dépit des exemples mentionnés plus haut, une partie de la social-démocratie fait preuve de méfiance envers le patriotisme et le bellicisme, leur opposant l’internationalisme prolétarien à mesure que les tensions entre pays capitalistes s’accentuent – notamment entre l’Allemagne et l’Angleterre. C’est dans cette conjoncture que les théoriciens marxistes classiques de l’impérialisme – en particulier Rudolf Hilferding, Rosa Luxemburg, Nicolas Boukharine, Lénine et Karl Kautsky – s’efforcent de définir les rapports entre l’avènement des grandes entreprises monopolistiques, leur activité internationale – notamment la place importante acquise par l’exportation de capitaux – et le déclenchement de rivalités entre les nations impérialistes. Dans cette perspective, il est important de garder à l’esprit que, même si de telles approches reconnaissent que « les avancées industrielles du monde occidental ont seulement été possibles au détriment du monde soi-disant sous-développé [30] », elles mettent avant tout l’accent sur les rivalités inter- impérialistes – et non sur leurs conséquences pour la périphérie.
Les débats marxistes classiques, ou l’impérialisme comme stade particulier du capitalisme
À la différence des suivantes, cette « première génération des théoriciens de l’impérialisme [31] » s’est développée au cœur des partis sociaux-démocrates européens, à l’extérieur du monde académique. Certes, cela n’a pas empêché Otto Bauer de mettre dès 1924 en garde des étudiants sociaux-démocrates contre le problème de la tension latente entre la base syndicale du mouvement ouvrier et le Doktorensozialimus, le socialisme des intellectuels [32]. Mais bien qu’étant des intellectuels, les premiers théoriciens de l’impérialisme étaient tous en même temps des dirigeants du mouvement social-démocrate international. Et tous ont rompu avec la social-démocratie de la IIe Internationale au cours de la Première Guerre mondiale. Cette rupture politique est directement liée aux efforts déployés à l’époque en vue de formuler une théorie de l’impérialisme. En dépit de ce qui les distingue, ces analyses dites « classiques » de l’impérialisme ont en commun de l’envisager comme une phase du capitalisme particulièrement favorable au déclenchement de guerres, et d’en faire conséquemment porter la responsabilité non pas à tel ou tel État en particulier, mais à cette configuration générale. Or c’est ce diagnostic que la politique menée par les différentes sections nationales de la social- démocratie internationale a pris à contrepied. En 1914, soit sept années seulement après la déclaration de Stuttgart de la IIe Internationale – déclaration qui établissait qu’en cas de menace de guerre la classe ouvrière devait à tout prix lutter contre son déclenchement –, elles soutenaient l’effort de guerre de leurs gouvernements nationaux respectifs.
Le contexte intellectuel dans lequel sont élaborées les théories classiques de l’impérialisme est marqué par la publication des livres 2 et 3 du Capital de Marx, respectivement en 1885 et 1894 ; celles-ci se donnent en effet pour objectif de poursuivre et d’actualiser l’analyse du capitalisme proposée par l’auteur du Manifeste. Marx avait prévu de diviser sa critique de l’économie politique en six parties : le capital, la propriété des terres, le travail salarié, l’État, le commerce international et le marché mondial. Or ce projet n’ayant pu être mené à terme, il y manque une analyse approfondie de certains éléments centraux pour l’étude de l’impérialisme, comme l’État et le développement international du capitalisme. C’est pourquoi, dès la préface de son Capital financier – première analyse marxiste de l’impérialisme en tant que tel –, Hilferding indique que son objectif est de fournir « une explication scientifique des phénomènes économiques du développement capitaliste moderne », afin de poursuivre l’élaboration du « système théorique de l’économie politique classique […] qui trouve sa plus haute expression chez Karl Marx [33] ». Cette ambition trouve sa justification dans le passage opéré autour de 1875 d’une période où le capitalisme était adossé au libre-échange (l’« ère du capital ») à une autre où il l’est à l’impérialisme (l’« ère des empires »).
Au fondement d’une telle approche se trouve l’apport fondamental de Marx concernant le caractère historique du capitalisme, qui permet d’en saisir les particularités en le distinguant d’autres modes de production auxquels l’histoire a donné naissance. C’est ce que souhaite rappeler Boukharine lorsqu’il énonce que « chaque période historique possède ses lois propres » et qu’« aussitôt que la vie a dépassé un stade d’évolution donné, aussitôt qu’elle passe d’une phase donnée à une autre, elle commence à obéir à d’autres lois [34] » – assertion qui n’exclut bien entendu pas l’existence de lois régissant la vie sociale de manière transhistorique, à l’instar de la lutte des classes. Autrement dit, le capitalisme est cette période particulière de la lutte des classes caractérisée par l’émergence de l’impératif d’accumulation du capital, lequel a pour particularité d’être « non un objet, mais un rapport social de la production, adéquat à une forme historiquement déterminée de la société [35] ». Appliquée à l’analyse de l’impérialisme, cette méthode conduit à l’envisager non comme un phénomène transhistorique – en assimilant par exemple la logique d’expansion des nations modernes à celle des Vikings ou encore de l’Empire romain –, mais comme le résultat d’une évolution particulière du capitalisme. Les théoriciens de l’impérialisme ont donc en partage d’ancrer « la dynamique de l’activité sociale et du développement historique dans les racines de la production et reproduction de moyens d’existence [36] ». Et ce n’est pas un hasard si l’ouvrage d’Hilferding a pour sous-titre « étude sur le développement récent du capitalisme ». Cela signifie que l’impérialisme ne relève pas d’un quelconque désir abstrait de conquête, et qu’il est inenvisageable d’y mettre fin sans dépasser le système qui l’a engendré.
Reste à décrire par quels mécanismes le capitalisme sécrète l’impérialisme. À cet égard, trois processus exposés dans le Capital ont retenu une attention particulière chez les théoriciens classiques de l’impérialisme : la reproduction du capital, la baisse tendancielle du taux de profit et la concentration ainsi que la centralisation du capital. La question de la reproduction est notamment abordée par Luxemburg dans L’Accumulation du Capital, où cette dernière s’interroge sur un double problème : d’un côté la possibilité de réaliser de la plus-value sur un marché, une fois qu’elle a été extraite de la force de travail ; de l’autre la possibilité d’un déséquilibre entre la production de biens intermédiaires et la production de biens de consommation. Ce double problème contient le risque de crises de sous-consommation qui peuvent provoquer une fuite en avant, c’est-à-dire la recherche de nouveaux marchés à l’extérieur des frontières nationales. Dans Le Capital financier, Hilferding s’est quant à lui particulièrement attaché à l’étude des contretendances susceptibles de contrecarrer la baisse tendancielle du taux de profit, parmi lesquelles on trouve l’expansion en dehors de l’économie nationale. Enfin, le troisième problème peut être résumé ainsi : la mise en concurrence de différents capitaux tend vers une situation de concentration et de centralisation de ces derniers à l’échelle nationale. Autrement dit, les entreprises capitalistes ont tendance à croître en taille et à décroître en nombre, donc à influer de manière croissante sur la politique, y compris étrangère, des nations. La recherche d’une meilleure compréhension de ce lien entre capitalisme monopolistique et impérialisme est liée à l’importance historique de l’avènement de la « grande firme », qui a impressionné beaucoup de penseurs du début du XXe siècle, et au fait que le penseur de l’impérialisme le plus connu, Lénine, a particulièrement insisté sur cet aspect. Cela étant posé, on peut dire que les controverses auxquelles ces problèmes donnent lieu et qui animent la première vague de débat sur l’impérialisme s’articulent autour trois éléments d’analyse : les rapports de forces entre les pays du centre et le lien entre capitalisme et guerre ; la périodisation du capitalisme ; le rapport entre la théorie et la pratique politique qui vise le dépassement du capitalisme.
La contribution structurante
de Rudolf Hilferding
Après des études de médecine à l’Université de Vienne, Hilferding intègre l’école du Parti social-démocrate d’Allemagne (SPD) pour y enseigner l’économie politique. C’est dans ce cadre qu’il initie la rédaction du Capital financier, qu’il poursuivra plus tard en tant que rédacteur du journal social-démocrate Vorwärts, dans un contexte marqué par l’émergence en Europe et en Amérique du Nord de ce qu’il nomme le capital financier.
L’enjeu est pour lui de comprendre la réduction de la concurrence et le réagencement des rapports entre État et grandes entreprises alors observables dans pays capitalistes les plus avancés et particulièrement en Allemagne. Des entreprises de grande taille s’y développent alors sous l’effet de l’émergence de la société par actions et d’accords plus ou moins tacites entre ces entreprises. L’émergence du capital financier correspond donc à la suppression de la libre concurrence par les cartels et trusts et au resserrement des liens entre le capital industriel et bancaire, sous l’égide de ce dernier [37].
Hilferding met en évidence l’importance des transformations organisationnelles du capitalisme de son époque. L’émergence de la société par actions, qui permet de séparer le profit du contrôle de l’entreprise, a un impact direct sur la forme que prend le processus d’accumulation du capital : alors qu’auparavant les marges de manœuvre d’une entreprise étaient considérablement limitées par la situation financière de son propriétaire et par l’obtention de crédits bancaires, la société par actions permet l’agrégation des capitaux d’une multitude d’actionnaires, ce qui favorise l’acquisition d’avantages concurrentiels. Or en plus de faciliter les levées de fonds, cette innovation juridique confère un pouvoir considérable aux détenteurs d’importants portefeuilles d’actions. Le pouvoir économique s’en trouve d’autant plus concentré et centralisé. Parallèlement, cette dynamique transforme les relations existantes entre les entreprises au bénéfice des mêmes monopoles, dans la mesure où « dans les rapports de dépendance mutuelle des entreprises capitalistes, c’est la puissance financière qui décide laquelle se trouve placée sous la dépendance de l’autre [38] ». Toutes les entreprises se trouvent ainsi exposées à la pression de ce processus auto-entretenu de cartellisation.
Une telle analyse ne concerne pas seulement le capital industriel, mais également le secteur bancaire. Selon Hilferding, la fonction de collecte de fonds que remplissent les banques leur confère un rôle pivot qui se décline sur trois plans : elles centralisent le capital-argent, deviennent propriétaires de capital industriel via la détention d’actions, et promeuvent enfin la monopolisation afin de minimiser les risques de défaut de paiement. La formation du capital financier, qui constitue l’aboutissement de ce processus d’imbrication des grandes banques et des entreprises du secteur de l’industrie, marque le passage du libre-échange à une nouvelle période de l’histoire du capitalisme, que l’historien Eric Hobsbawm a appelée l’« ère des empires [39] ». Hilferding résume ainsi ce profond bouleversement : « Le capital financier s’accroît au fur et à mesure du développement du système des sociétés par actions et atteint son apogée avec la monopolisation de l’industrie. Le revenu industriel acquiert ainsi un caractère plus sûr et plus constant. Par là, les débouchés dans l’industrie se multiplient pour le capital bancaire. Mais la disposition du capital bancaire, c’est la banque qui la possède, et le contrôle des banques, ce sont les détenteurs de la majorité des actions bancaires qui l’exercent [40]. » En promouvant cette dynamique, les banques se placent dans une situation qui les oblige à intervenir toujours davantage dans l’industrie, phénomène accru par la substitution progressive du capital financier au capital commercial. Et surtout, ce développement du capital financier induit un affaiblissement de la concurrence sur les marchés, même s’il ne faut pas perdre de vue qu’une telle analyse se fonde avant tout sur le cas allemand et, dans une moindre mesure, états-unien.
La diversité des capitalismes nationaux occupe une place centrale dans le développement du capital financier. Elle est en effet à l’origine d’un des mécanismes fondamentaux de ce qui sera décrit plus tard comme le « développement inégal et combiné », à savoir le « fouet des nécessités extérieures [41] ». Hilferding considère notamment que c’est le développement du libre-échange qui, en augmentant la pression concurrentielle, a induit le rattrapage des entreprises anglaises par leurs rivales allemandes. Selon lui, l’antériorité du développement du capitalisme outre-Manche a permis aux capitalistes anglais de développer et consolider leurs entreprises à l’abri de la concurrence économique, leur offrant par la suite un avantage concurrentiel qui a les a protégés d’une dynamique poussant à la centralisation du capital. Inversement, la pression concurrentielle exercée par les capitalistes anglais a obligé les capitalistes allemands à lever des fonds considérables en un temps limité. La concurrence internationale a donc façonné l’organisation différenciée du capital d’un pays à l’autre, et contribué à donner aux banques allemandes un rôle central dans le fonctionnement de l’économie de leur pays. Ces particularités transforment les rapports entre classe possédante et État à l’intérieur de chaque pays, puisque l’émergence du capital financier contribue à l’homogénéisation des intérêts de la classe possédante nationale. L’intensité croissante des liens qui unissent les représentants des banques et ceux de l’industrie tend à rendre ces derniers interchangeables : les uns siègent aux conseils d’administration des autres et vice- versa. Cette homogénéité d’intérêts entre les grandes firmes monopolistiques resserre à son tour les liens entre la classe dominante et l’État, ce que manifestent l’évolution des droits de douane et le soutien apporté aux investissements directs à l’étranger.
Il serait toutefois caricatural d’attribuer à Hilferding l’idée d’une totale homogénéité de la classe des propriétaires d’entreprise. Ses travaux sont marqués par les vifs débats dont fait l’objet la politique commerciale depuis le milieu du XIXe siècle, opposant les défenseurs du libre-échange à ceux du protectionnisme. Confrontés à la supériorité des entreprises anglaises, les pays en phase de rattrapage avaient alors mis en place des droits de douane importants, ce qui non seulement limitait les débouchés des producteurs anglais, mais constituait implicitement une remise en cause de l’hégémonie mondiale anglaise. Excluant la possibilité que des monopoles se forment à l’échelle mondiale, Hilferding considère que le protectionnisme favorise le développement de monopoles nationaux. Plus les droits de douane nationaux sont élevés, plus les monopoles nationaux sont en mesure de fixer sur le marché domestique des prix supérieurs à ceux pratiqués sur les marchés extérieurs. Une telle politique ne peut cependant pas s’appliquer à tous les secteurs, dans la mesure où la hausse des prix conduirait aussi à une hausse des salaires réels [42]. Par conséquent, les droits de douane constituent aussi un mécanisme de répartition de la plus-value entre les monopoles et les secteurs engagés dans la concurrence.
Un apport majeur d’Hilferding à l’analyse de la compétition qui se livre sur la scène internationale réside dans l’interprétation qu’il propose de l’évolution du commerce mondial à l’aune de la mise en œuvre des politiques protectionnistes : « De moyen de défense contre la conquête du marché intérieur par les industries étrangères, il est devenu un moyen de conquête des marchés extérieurs par l’industrie nationale, d’arme défensive du faible une arme offensive du fort. » Mobilisé dans une perspective d’expansion économique, le protectionnisme établit un continuum d’exploitation entre l’espace national et l’espace international : dans la mesure où il peut fixer les prix sur le marché domestique, le monopole s’y assure un profit supplémentaire, profit qui est donc corrélé à la dimension de l’espace économique contrôlé par un État. En tant que stratégie mise en œuvre dans le cadre de la compétition entre nations capitalistes, la constitution de monopoles repose en conséquence sur trois éléments : « Premièrement, créer un territoire économique le plus vaste possible, qui sera, deuxièmement, protégé par de hautes barrières douanières contre la concurrence étrangère, et deviendra ainsi, troisièmement, un territoire réservé aux unions nationales à caractère de monopole [43]. »
À côté des mesures protectionnistes, l’autre instrument central de la compétition internationale dans l’analyse d’Hilferding est l’« exportation de capital » – on parle plutôt aujourd’hui d’investissements directs à l’étranger (IDE) et d’investissements de portefeuille. À l’échelle internationale, on observe une croissance significative des investissements à partir des années 1870. Cette dynamique, avant tout soutenue par les secteurs économiques où la concentration du capital est la plus forte – comme l’industrie électrique avec ses géants AEG en Allemagne et General Electric aux États-Unis – et qui renforce en retour la puissance des monopoles concernés, est le signe d’une accentuation des rivalités inter-impérialistes, dans la mesure où le nombre de territoires susceptibles d’accueillir de tels IDE est nécessairement limité. Dans un contexte de rivalité inter-étatique entre grandes puissances, Hilferding distingue implicitement trois destinations de l’exportation de capital : celle-ci peut viser une partie sous-développée de l’espace économique de la métropole, par exemple une colonie ; ou bien un espace indépendant mais sous-développé, parfois dans la perspective d’une intégration éventuelle de celui-ci ; ou bien encore un territoire contrôlé par un autre État [44]. À ces trois destinations correspondent autant de ressorts de l’exportation de capital. La volonté d’augmenter les rendements sous-tend chaque investissement et dès lors que ce dernier est réalisé en dehors de l’espace économique de la métropole, il vise également à contourner les barrières protectionnistes instaurés par d’autres États. Si l’exportation de capital se dirige vers un pays indépendant et sous-développé elle peut amorcer un processus d’intégration pour protéger l’investissement. Si elle est destinée à une autre grande puissance elle représente un défi direct pour les monopoles locaux et y dilue le caractère national du capital. Mais quoiqu’il en soit, il résulte de tels processus d’investissement, dont l’État assure le bon déroulement, des intrants moins chers, le développement des industries produisant des biens d’équipement et une hausse du taux de profit.
À partir de ces considérations sur la transformation du capitalisme, Hilferding analyse les relations entre les différents États européens. Ces dernières se caractérisent par une compétition inter-étatique accrue, que traduit le remplacement du libre-échange par le protectionnisme et le niveau croissant des exportations de capital, selon un mouvement qui tend à diviser marché mondial en une multiplicité de territoires économiques exclusifs. Cette course à l’expansion est inhérente à la logique de l’accumulation du capital. Dans cette configuration en effet, le moindre retard économique se traduit par une perte de compétitivité qui réduit durablement les capacités d’action du capital financier national concerné. Cette tendance objective se trouve renforcé par un élément subjectif : à mesure que se développe le capitalisme, l’« idée nationale », initialement adossée à celle du droit à l’indépendance des nations, se trouve « transformée en l’idée de l’élévation d’une propre nation au-dessus de toutes les autres [45] ». Si l’influence d’Hilferding sur les travaux ultérieurs de Boukharine et de Lénine témoigne du caractère novateur de son approche de l’économie politique, son analyse de la guerre, principale expression de l’impérialisme, diverge de celles de ses successeurs russes. Concrètement, l’impérialisme nourrit selon Hilferding deux tendances contradictoires : d’un côté l’intensification des conflits inter-étatiques, de l’autre l’émergence d’intérêts communs aux États capitalistes. Il souligne notamment l’asymétrie entre le grand empire britannique et les ambitions de l’Allemagne. Des puissances plus faibles comme la France, la Belgique, la Russie ou les Pays-Bas possèdent alors un empire colonial plus vaste que l’Allemagne, ce qui produit une « situation qui tend à aggraver considérablement l’antagonisme entre l’Allemagne et l’Angleterre avec ses satellites, et ne peut que mener à une solution de force ». Parallèlement, les pays où le capitalisme s’est développé de manière plus précoce, à savoir l’Angleterre, les Pays-Bas et la France, exportent du capital davantage sous forme de prêts que d’investissements, contrairement aux puissances nouvelles que sont les États-Unis et l’Allemagne, dont les entreprises bénéficient parfois en revanche desdits prêts – c’est ainsi que se crée « une certaine solidarité des intérêts internationaux du capital [46] ».
Quant à savoir laquelle de ces tendances est la plus susceptible de l’emporter, il considère que « cela dépend avant tout des perspectives de gain qu’offrirait le combat ». Pour autant, il ne décèle pas dans cette dynamique les prémisses d’une fusion des capitaux à l’échelle internationale, capable de constituer le socle de tels intérêts communs. Il considère alors en effet que les nations capitalistes privilégient une politique d’équilibre des puissances, d’une part car à l’échelle internationale, « toute lutte victorieuse entraînerait un renforcement du vainqueur aux dépens de tous les autres » et d’autre part car au niveau domestique, les bourgeoisies nationales craignent le mouvement ouvrier [47].
Si son propos insiste avant tout sur l’évolution des économies des États capitalistes, Hilferding n’en a pas pour autant entièrement ignoré les conséquences de l’impérialisme sur la périphérie. Ainsi, il estime que l’exportation de capital implique un engagement en termes d’infrastructures dans la périphérie. Or, cet engagement n’y garantit pas la stabilité politique car la colonisation découle des rapports sociaux capitalistes, auxquels la violence est inhérente : « Les méthodes de violence font partie intégrante de la politique coloniale qui sans elles perdrait son sens capitaliste, tout comme l’existence d’un prolétariat sans terre est une condition indispensable du capitalisme. Faire une politique coloniale en évitant ses méthodes de violence est aussi absurde que de vouloir abolir le prolétariat en conservant le capitalisme. » D’un même mouvement, il s’oppose aux approches qui considèrent l’exportation de capital dans les colonies comme une aide au développement, en soulignant que des rapports de hiérarchie et de dépendance se mettent en place dès lors que le capital financier agit de sorte à s’assurer la mainmise sur un espace dans le but de favoriser son industrie domestique. Et que ce phénomène s’aggrave de manière concomitante au renforcement des rivalités inter- étatiques. Enfin, il considère que le rapport hiérarchique entre le centre et la périphérie ne réduit pas les peuples périphériques à un simple rôle de spectateur. Au contraire, « le capitalisme lui-même fournit aux indigènes les voies et moyens de leur libération [48] », dans la mesure où il favorise l’unité nationale, identifiée à l’obtention d’une liberté économique et culturelle. Le danger représenté par les mouvements de libération nationale pour les intérêts de la métropole ne laissait selon lui d’autre recours que la violence aux États impérialistes.
L’impérialisme chez Rosa Luxemburg
Dès sa fondation en 1906, l’école du SPD est vue d’un mauvais œil par la police prussienne, ce que reflètent notamment les 475 pages d’observations rédigées par des agents à son sujet en à peine quelques mois [49]. Celle-ci trouve dans la présence d’enseignants étrangers au sein de l’école berlinoise un prétexte pour contrecarrer ses activités. En octobre 1907, Hilferding est expulsé en même temps que le néerlandais Anton Pannekoek qui y enseignait aussi, ce qui conduit Karl Kautsky à demander à Rosa Luxemburg de remplacer le « beau Rudolf ». C’est dans ce cadre que Luxemburg rédige L’Accumulation du capital, qui paraît en 1913. Elle pensait avoir découvert une erreur logique dans la conception marxienne de la reproduction élargie du capital : alors que les schémas de reproduction exposés dans le deuxième livre du Capital illustrent que la réalisation de la plusvalue et donc l’accumulation du capital est possible dans une société purement capitaliste, Luxemburg considérait cette réalisation comme impossible du fait d’une demande chroniquement insuffisante. En réaction, elle développe son analyse dans deux directions, soutenant d’une part que pour faire face aux crises de sous- consommation, les entreprises capitalistes doivent vendre leurs marchandises à des acheteurs résidant dans des pays non capitalistes et d’autre part, que la pression concurrentielle conduit les capitaux à s’étendre au monde non capitaliste. In fine, il en résulte l’intégration du monde entier dans le système capitaliste.
Luxemburg considère en effet que le capitalisme s’étend jusqu’aux espaces les plus reculés du monde non pas seulement à cause de la concurrence, mais du fait du manque chronique de débouchés dans leur propre pays auquel doivent faire face les entreprises des métropoles. Ayant curieusement exclu la possibilité que des achats mutuels entre les capitalistes permettent d’élargir la production et donc d’alimenter le processus d’accumulation, elle considère qu’il existe de manière structurelle une part de la production qui ne peut pas être écoulée sur le marché domestique [50]. Dans la mesure où la production doit être vendue sur un marché, le monde non capitaliste a donc pour fonction de maintenir en vie le monde capitaliste, et c’est cette configuration qui fait le lit des rivalités inter-impérialistes. Afin d’ouvrir de nouveaux marchés à l’étranger, les États métropolitains disposent de moyens variés comme l’accord de crédits internationaux, l’instauration de droits de douane protectionnistes ou encore les dépenses d’armement. Cependant, dans la mesure où la conquête de marchés rencontre inéluctablement des limites géographiques ou « naturelles », l’intégration totale des formations sociales non capitalistes au processus de valorisation du capital marque selon elle le début de la fin pour le capitalisme, ne laissant d’autre alternative que le socialisme ou la barbarie, pour reprendre une de ses formules ultérieures restée célèbre. Dans cette optique, les guerres impérialistes sont précipitées par la raréfaction des espaces extérieures au capitalisme, selon un raisonnement qui mène Luxembourg à projeter une situation où le monde entier est intégré au capitalisme, et où donc son effondrement menace : « Le capitalisme est la première forme économique douée d’une force de propagande ; il tend à se répandre sur le globe et à détruire toutes les autres formes économiques, n’en supportant aucune autre à côté de lui. Et pourtant il est en même temps la première forme économique incapable de subsister seule, à l’aide de son seul milieu et de son soi nourricier. Ayant tendance à devenir une forme mondiale, il se brise à sa propre incapacité d’être cette forme mondiale de la production. Il offre l’exemple d’une contradiction historique vivante ; son mouvement d’accumulation est à la fois l’expression, la solution progressive et l’intensification de cette contradiction. À un certain degré de développement, cette contradiction ne peut être résolue que par l’application des principes du socialisme [51]. »
Le mouvement ainsi décrit se traduit par une lutte contre les différentes organisations sociales du monde non capitaliste. Ce mouvement prend quatre formes : appropriation directe de ressources, « libération » de la force de travail autochtone, introduction de l’économie marchande dans les espaces à intégrer et enfin séparation en leur sein de l’agriculture et de l’artisanat. Autrement dit, s’y articulent l’échange marchand et l’emploi de la violence physique. Dans ce dernier cas, l’État capitaliste joue un rôle particulièrement important, en permettant notamment la transformation de la force de travail humaine en marchandise.
De cette analyse découle une définition de l’impérialisme comme « expression politique du processus de l’accumulation capitaliste se manifestant par la concurrence entre les capitalismes nationaux autour des derniers territoires non capitalistes encore libres du monde [52] ». Contrairement à ce que suggère le récit libéral des origines du capitalisme, qui fait de ce dernier le résultat d’une extension paisible du « doux commerce [53] » considéré comme un vecteur de la « paix universelle [54] », son développement repose sur un processus d’expropriation massif des populations rurales que sert à désigner le terme d’« accumulation primitive » employé par Marx. L’innovation de Luxemburg consiste ici à conférer une plus grande extension à ce concept, en envisageant la violence qu’il désigne non comme un élément propre à une phase particulière de la genèse du capitalisme, mais comme un phénomène inhérent à son fonctionnement [55]. Violence puisqu’il s’agit d’expropriation et puisque les tentatives d’intégration d’espaces demeurés extérieurs au capitalisme via leur appropriation par une métropole sont toujours susceptibles de rencontrer des résistances armées : « Le capital ne connaît aucune autre solution à ce problème [des limites spatiales de l’accumulation] que la violence, qui est une méthode permanente de l’accumulation comme processus historique depuis son origine jusqu’à aujourd’hui [56]. » Cette approche est au cœur des débats contemporains concernant l’émergence d’un « nouvel impérialisme » – elle a notamment inspiré l’analyse des processus d’« accumulation par dépossession » proposée par David Harvey, sur laquelle nous revenons plus loin [57].
Cette analyse, qui met donc l’accent sur la politique économique et la violence physique en tant que leviers mobilisés par l’État en vue de s’adapter aux contraintes inhérentes au capitalisme, permet en outre d’identifier l’appropriation de travail et de matières premières à bas prix comme autant de visées des politiques impérialistes. Autrement dit, l’impérialisme peut avoir pour ressort la recherche d’une baisse de la valeur des moyens de production et de la force de travail, élément qui fera plus tard l’objet d’importants débats, notamment entre Lénine et Boukharine. Par ailleurs, L’Accumulation du capital amorce la prise en considération des liens entre les pays capitalistes développés et le reste du monde, auparavant peu explorés au sein de la pensée marxiste. L’intérêt porté par Luxemburg aux interactions entre les espaces régis par le capitalisme et ceux où existent d’autres modes de production, plutôt qu’aux seules rivalités inter-étatiques entre grandes puissances [58], son insistance sur la coexistence d’un capitalisme fortement développé et de processus répétés d’accumulation primitive, demeurent aujourd’hui ses contributions majeures.
Boukharine, Lénine et Kautsky face
à la Première Guerre mondiale
En 1914, soit un an après la parution de L’Accumulation du capital et quatre ans après celle du Capital financier, il est clair que la solidarité inter-impérialiste abordée par Hilferding s’avère largement contrebalancée par les tendances guerrières inhérentes à la dynamique d’accumulation du capital monopoliste. Un an plus tard, en pleine Première Guerre mondiale, le social-démocrate russe Nicolas Boukharine écrit L’Économie mondiale et l’Impérialisme – ouvrage préfacé par Lénine – qui, victime d’abord de la censure militaire, puis d’une descente de police à l’imprimerie des bolcheviks, paraît finalement après L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme. Si la postérité a surtout retenu l’« essai de vulgarisation » de Lénine, celui-ci a été profondément influencé par l’analyse de Boukharine, au demeurant bien plus poussée.
Dans son ouvrage, plutôt que de réduire l’impérialisme aux politiques de conquête d’un pays, Boukharine insiste sur le système de rivalités dans lequel se trouvent les grandes puissances. Ainsi, il définit l’impérialisme comme « reproduction élargie de la concurrence capitaliste [59] ». Approfondissant l’approche d’Hilferding, il étudie notamment les conséquences internationales de la concurrence de capitaux monopolistiques, en mettant l’accent sur la conjonction des logiques de nationalisation et d’internationalisation du capital. Il considère en effet que la guerre est le produit du développement concomitant des deux phénomènes contradictoires que sont la croissance des interdépendances à l’échelle mondiale et la consolidation de blocs nationaux. À l’échelle internationale, le développement du commerce et des IDE instaure en effet une division du travail configurée par les blocs impérialistes, dont il résulte un développement inégal des forces productives qui divise le monde « entre la ville et la campagne [60] », autrement dit entre les pays industrialisés et la périphérie. Reposant sur la surproduction de capital, cette tendance conduit les capitaux du centre vers la périphérie où la composition organique du capital est plus faible, et favorise l’émergence d’un marché mondial des capitaux et des biens.
Là où Luxemburg mettait en avant l’importance des crises de sous-consommation dans l’expansion du capitalisme, Boukharine insiste sur l’accumulation du capital, qui requiert un équilibre entre les investissements réalisés par la métropole à l’intérieur de l’espace qu’elle contrôle formellement et ceux projetés au-dehors de cet espace. Cet espace formellement contrôlé comprend les métropoles et les colonies, mais exclut les semi-colonies. En effet, l’époque de l’impérialisme « n’est pas seulement caractérisée par les deux groupes principaux de pays : possesseurs de colonies et pays coloniaux, mais encore par des formes variées de pays dépendants qui, nominalement, jouissent de l’indépendance politique, mais qui, en réalité, sont pris dans les filets d’une dépendance financière et diplomatique [61] », constat qui permet de souligner que les effets de l’impérialisme sur la périphérie ne se réduisent pas à des processus de colonisation.
Soulignant qu’au plan national l’élimination des structures les moins concurrentielles dans chaque secteur – en Allemagne et aux États-Unis, les trusts pèsent alors plus de 80 % de la production totale dans certains secteurs – est suivie de la création d’entreprises combinées embrassant plusieurs secteurs, Boukharine décèle une tendance fondamentale à la transformation en une grande entreprise unique de toute économie nationale, qui entraîne une « lutte âpre d’adversaires formidables sur le marché mondial [62] ». La prédominance de la grande entreprise combinée modifie la donne en matière de concurrence économique : contrôlant un réseau de transport, celle-ci peut imposer des tarifs prohibitifs, interdire à la concurrence l’accès aux matières premières, au crédit ou encore à certains débouchés et pratiquer le dumping. Mais la puissance de telles entreprises ne se limite pas au domaine strictement économique. L’essor de la grande entreprise combinée entraine son agglomération avec l’État à l’échelle nationale, ce que Boukharine désigne comme la création d’un « trust capitaliste d’État ». Cette transformation conduit au plan international à un usage stratégique des droits de douane mais aussi à leur contournement par l’investissement et à des traités commerciaux incluant notamment certaines commandes obligatoires ou des emprunts à des taux d’intérêt élevés. Parallèlement, le progrès technique, notamment dans le domaine des transports, ouvre de nouveaux débouchés aux capitaux.
La nouveauté que constitue l’exportation de capital accroît néanmoins le risque qui pèse sur les investissements : alors que les exportateurs ne risquaient auparavant que la perte de leurs marchandises, désormais cette menace concerne l’ensemble des fonds investis. D’où la nécessité pour de tels investissements d’être protégés, y compris si besoin par l’usage de la force militaire, ce qui explique pour Boukharine la course aux armements qu’il constate au début du XXe siècle. Une telle configuration implique un resserrement des liens entre la classe dominante et le gouvernement, qui se transforme en « directeur suprême du trust capitaliste national [63] ». Aussi, dès que la politique commerciale s’avère un levier insuffisant pour maintenir le niveau des profits, les États capitalistes se trouvent poussés à l’expansionnisme et à la conquête militaire, selon un schéma qui mène « infailliblement […] à la phase décisive de la politique impérialiste : la guerre [64] ».
En révélant ainsi « le conflit entre le développement des forces productives et la limitation nationale de l’organisation productive [65] », Boukharine montre que l’importance de l’espace national dans la lutte des classes tient au fait que sur le marché mondial ne s’opposent pas seulement la bourgeoisie et le prolétariat, mais aussi des fractions nationales de la classe dominante qui sont en concurrence pour le partage de la plus-value à l’échelle mondiale. Dans cette perspective, seules les guerres qui découlent du développement du capital financier sont considérées comme impérialistes ; l’impérialisme apparaît seulement à partir d’un certain degré de développement historique. Cette perspective est partagée par Lénine, dont le titre de l’essai, L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme, est à cet égard très clair. Ce texte d’intervention, qui ne présente pas d’avancée majeure par rapport aux approches évoquées jusqu’ici, vise avant tout à critiquer sur un plan théorique les erreurs politiques des sociaux- démocrates réformistes, au rang desquels figurent notamment Kautsky, mais aussi Hilferding, à qui il reproche d’estomper « la profondeur des contradictions de l’impérialisme et le caractère inévitable de la crise révolutionnaire qu’il engendre », écueil qui autorise l’alliance avec des gouvernements bourgeois [66].
Lénine définit l’impérialisme selon « cinq caractères fondamentaux » : « 1/ concentration de la production et du capital parvenue à un degré de développement si élevé qu’elle a créé les monopoles, dont le rôle est décisif dans la vie économique ; 2/ fusion du capital bancaire et du capital industriel, et création, sur la base de ce “capital financier”, d’une oligarchie financière ; 3/ l’exportation des capitaux, à la différence de l’exportation des marchandises, prend une importance toute particulière ; 4/ formation d’unions internationales monopolistes de capitalistes se partageant le monde, et 5/ fin du partage territorial du globe entre les plus grandes puissances capitalistes. » Les trois premiers critères s’inspirent clairement du travail d’Hilferding. Toutefois, concernant l’importance de l’exportation du capital Lénine semble plutôt s’inspirer de l’ouvrage Imperialism de J. A. Hobson, paru en 1902. En effet, d’après Lénine « si le capitalisme pouvait […] élever le niveau de vie des masses populaires qui, en dépit d’un progrès technique vertigineux, demeurent partout grevées par la sous-alimentation et l’indigence, il ne saurait être question d’un excédent de capitaux ». Par conséquent, « la nécessité de l’exportation des capitaux est due à la “maturité excessive” du capitalisme dans certains pays, où (l’agriculture étant arriérée et les masses misérables) les placements “avantageux” font défaut au capital [67]. » Cette explication fait procéder l’absence de marché d’un manque de pouvoir d’achat induit par la pauvreté de la majorité de la population dans les pays industrialisés. Il envisageait même le départ d’Europe des principales branches de l’industrie pour l’Asie et l’Afrique, perspective qui peut certes paraître curieusement juste aux yeux de l’observateur contemporain, mais qui n’a en réalité commencé de s’avérer pertinente qu’à partir des années 1970. Lénine reprend aussi à Hilferding (et Boukharine) les points quatre et cinq mais rencontre des difficultés à les articuler. D’un côté, son texte suggère que des groupements internationaux réunissant les grandes entreprises de divers pays émergent, ce qui démontre la capacité des monopoles à coopérer par-delà les frontières nationales pour se partager les marchés. De l’autre il souligne que, le partage du monde étant désormais terminé, aucun pays du centre ne pourra agrandir l’espace sous son contrôle sans affronter une autre grande puissance. Pour réussir à articuler ces deux points, une théorisation de l’État moderne aurait été requise ou, à défaut, une analyse du rapport entre l’État et les dynamiques d’accumulation. C’est précisément ce que proposent Hilferding et Boukharine en interrogeant les conséquences de la monopolisation sur la politique extérieure et l’économie mondiale.
Comme on l’a suggéré, le principal intérêt de l’ouvrage réside plutôt dans sa visée polémique. Lénine y reproche à Kautsky de ne pas avoir pris la mesure de la manière dont les décisions politiques des grandes puissances sont liées à l’évolution économique de l’époque, ce qui conduirait le dirigeant allemand à réduire l’impérialisme à une option politique possible parmi d’autres et à envisager l’éventualité qu’une politique non guerrière puisse être menée à l’époque du capital financier. Derrière les désaccords de fond se joue une bataille proprement politique de la plus haute importance pour la social-démocratie. Inspirée notamment par certains écrits de Marx datant d’avant la révolte des Cipayes en 1857 [68], une grande partie de cette dernière considère que le capitalisme constitue une étape inévitable sur le chemin menant inexorablement à l’avènement d’une société sans classes. Celle-ci considère donc que toute société doit passer par le capitalisme, qui fondamentalement joue un rôle progressiste dans l’histoire de l’humanité. L’affirmation que l’impérialisme n’est qu’une politique possible parmi d’autres permet à la partie de la social-démocratie que représente Kautsky de maintenir à la fois son opposition de principe à la guerre et son appréciation positive du capitalisme en tant que vecteur d’un certain « progrès ». Lénine, plus proche en cela du Marx d’après 1857, oppose à cette perspective téléologique l’idée que le capitalisme ne débouche pas automatiquement sur le socialisme, et préconise en conséquence une politique révolutionnaire qui vise à défaire activement le capitalisme. Or dans la mesure où l’impérialisme correspond au dernier moment de développement du capitalisme, la lutte contre le premier ne peut pas selon lui être dissociée de celle contre le second.
Appliqué à la Première Guerre mondiale, le diagnostic de Lénine se traduit de la manière suivante : dans la mesure où l’antagonisme au sein des sociétés capitalistes repose sur un clivage posé en termes de classes sociales, les intérêts de la classe ouvrière ne sauraient être représentés par l’une ou l’autre des différentes classes dominantes en conflit. En 1914 pourtant, une grande majorité des sociaux-démocrates européens a soutenu l’effort de guerre de son gouvernement respectif, à l’encontre de la formule du Manifeste du Parti communiste selon laquelle « les ouvriers n’ont pas de patrie ». Et en effet, jusqu’aux travaux de Boukharine et de Lénine, la théorie de l’impérialisme n’avait pas réellement étudié les raisons susceptibles de conduire les travailleurs à accepter, voire à promouvoir, les politiques bellicistes et nationalistes de leurs gouvernements respectifs – les élections de 1907 en Allemagne attestent pourtant de la prégnance des idées nationalistes au sein de la classe ouvrière au début du XXe siècle : par le biais d’une campagne de propagande en soutien à la politique coloniale en Deutsch-Südwestafrika, la Namibie d’aujourd’hui, la droite avait réussi à infliger sa première grande défaite électorale au SPD, lui faisant perdre près de la moitié de sièges au parlement [69]. Méditant l’échec de la IIe Internationale à faire prévaloir un clivage de classe sur l’opposition entre les nations, Boukharine souligne que le social-patriotisme exprime l’association de la classe ouvrière à ses exploiteurs, et empêche d’ailleurs l’émergence d’intérêts communs entre les travailleurs et les colonisés. Insistant sur la dimension internationale du phénomène, Lénine s’inspire quant à lui des descriptions proposées par Marx et Engels de l’« embourgeoisement » du prolétariat anglais vivant aux dépens des peuples colonisés pour forger le terme d’« aristocratie ouvrière [70] » : en effet, seule la couche supérieure de la classe ouvrière bénéficie réellement de l’impérialisme à travers l’exploitation des peuples conquis. Comme Boukharine qui, considérant que la guerre montre à l’ouvrier (y compris qualifié) que « l’intérêt qu’il trouvait dans la politique impérialiste n’était rien en comparaison des plaies que la guerre lui inflige [71] », y voit une opportunité de briser l’association des ouvriers à leur État, Lénine considère cette guerre comme un révélateur susceptible d’ouvrir une période de révolution sociale – tout en mettant en garde contre l’attitude réductionniste qui ne confèrerait aucun effet propre au chauvinisme et au racisme dans le soutien d’une partie des ouvriers aux menées impérialistes de leurs États [72].
Mais revenons un instant sur l’approche de l’impérialisme de Kautsky, dite de l’ultra- impérialisme. Celle-ci repose sur l’idée suivante : si les politiques impérialistes sont bien adossées aux intérêts du capital financier, ce dernier ne domine pas les autres fractions du capital. Une telle approche suppose qu’il existe, à côté des monopoles, une fraction du capital industriel attachée à la paix et au libre-échange et que cette diversité d’intérêts au sein de la classe dominante permette le moment venu à la classe ouvrière de faire pencher la balance contre l’impérialisme. Elle met en outre en avant l’intérêt bien compris des grandes puissances à se répartir paisiblement les parties du monde à exploiter, si bien qu’en septembre 1914, quelque temps après le déclenchement de la guerre, Kautsky considère encore qu’une fois celle-ci terminée il serait envisageable de transférer le modèle du cartel à la sphère politique, en créant une « fédération des plus forts [73] ». La divergence entre ses positions et celles des leaders marxistes russes est donc non seulement théorique mais aussi politique, dans la mesure où ces derniers tiennent que seule la révolution est susceptible de constituer une échappatoire durable à la guerre. Contre Kautsky, Boukharine argumente que l’émergence d’un tel cartel supposerait une répartition égale des parts de marché entre les monopoles qui le composent, laquelle aurait à son tour pour condition un développement quasiment identique des forces productives au sein de ces différents espaces ainsi que des capacités militaires analogues, fait plutôt improbable. En somme, Boukharine reproche à Kautsky de ne pas admettre que la dynamique de l’accumulation fait de l’impérialisme un phénomène inhérent au capitalisme, analyse que partage Lénine, qui précise qu’il est pour lui « inconcevable en régime capitaliste que le partage des zones d’influence, des intérêts, des colonies, etc., repose sur autre chose que la force de ceux qui prennent part au partage, la force économique, financière, militaire, etc. Or, les forces respectives de ces participants au partage varient d’une façon inégale, car il ne peut y avoir en régime capitaliste de développement uniforme des entreprises, des trusts, des industries, des pays [74]. »
Ainsi balisés, les débats classiques autour de la notion d’impérialisme, s’ils apparaissent d’une grande richesse, n’en souffrent pas moins de certaines faiblesses. D’abord, le caractère capitaliste de l’État y est encore envisagé de manière trop instrumentale, de même qu’est conférée à la classe dominante une trop grande homogénéité. Les médiations politiques des forces économiques notamment y sont largement ignorées, ce que relève déjà à l’époque le théoricien Antonio Gramsci. Prêter une plus grande attention à l’existence maintenue de fractions au sein de la classe dominante aurait permis de rendre compte de la simultanéité d’une expansion mondiale effectivement indispensable dans certains secteurs de l’économie et du maintien d’autres secteurs plus centrés sur le développement économique domestique – ce qui n’enlève rien au constat selon lequel « grande partie des élites politiques espérait renforcer son pouvoir et la domination sur les marchés des grandes entreprises opérant depuis son territoire par la formation d’une propriété coloniale [75] ». Cette tendance à une vision instrumentale s’incarne aussi dans l’imprécision relative des usages faits du terme de monopole et la distinction trop tranchée entre un capitalisme « de concurrence » et un autre « des monopoles ». La réalité de la taille croissante des entreprises et de leurs ententes n’indique pas nécessairement une tendance à la domination de toute une économie nationale par une seule entreprise et la position de monopole, ou en réalité celle d’un oligopole, n’est jamais définitivement acquise, à moins de concevoir le capitalisme comme un régime piloté par des acteurs puissants et non comme une dynamique systémique sans centre de commandement unique.
Ces critiques ne sauraient toutefois pas masquer la puissance de la théorie classique de l’impérialisme lorsqu’il s’agit de rendre compte des tendances lourdes de l’économie politique internationale de l’époque qui a inspiré de nombreux penseurs critiques tout au long du XXe siècle : comme nous le verrons, la démarche consistant à porter un intérêt particulier aux conflits internationaux résultant des contradictions du capitalisme et à envisager la guerre comme le résultat de ces mêmes contradictions sera actualisée une première fois dans les années 1970, avant de l’être de nouveau dans les années 2000.
Notes
[1] Ernest Mandel, Marxist Economic Theory II, New York, Monthly Review Press, 1968, voir notamment le chapitre 13. ⤴️
[2] Voir respectivement Alexander Anievas et Kerem Nisancioglu, How the West Came to Rule: The Geopolitical Origins of Capitalism, Londres, Pluto Press, 2015, chapitre 4 et Silvia Federici, Caliban et la Sorcière, trad. fr. collective, Genève, Entremonde, 2014. ⤴️
[3] Alexander Anievas et Kerem Nisancioglu, How the West Came to Rule, op. cit., p. 275.e ⤴️
[4] Karl Marx, Le Capital. Livre premier, chapitre XXXI, Marxists.org, 1867, en ligne ⤴️
[5] Ernest Mandel, Marxist Economic Theory II, op. cit., p. 445. L’importance de ce processus économique ne doit pas conduire à oublier la place du fait militaire dans l’accaparement de nouveaux marchés par les Occidentaux : c’est bien au cours du XIXe siècle que le terme de « diplomatie de la canonnière » fut forgé pour désigner l’imposition de concessions économiques par la force. Voir Peter Gowan, « Instruments of Empire », New Left Review, no 21, 2003. ⤴️
[6] Jacques Adda, La Mondialisation de l’économie, Paris, La Découverte, 2012, p. 60-62 ; David Harvey, Le Nouvel Impérialisme, trad. fr. J. Batou et C. Georgiou, Paris, Les Prairies Ordinaires, 2010. ⤴️
[7] Ernest Mandel, Marxist Economic Theory II, op. cit., p. 449. ⤴️
[8] Jules Ferry, Le Tonkin et la Mère-Matrie, Paris, Hachette, 2012. ⤴️
[9] Ernest Mandel, Marxist Economic Theory II, op. cit., p. 450 ⤴️
[10] Léon Trotsky, Histoire de La Révolution Russe I, trad. fr. M. Parijanine, Paris, Le Seuil, 1995, p. 41. ⤴️
[11] Chez Anievas et Nisancioglu « avancé » et « arriéré » désignent des déséquilibres qui concernent le pouvoir et sa reproduction au sein des et entre les sociétés. Les capitalistes ne sont donc « ni temporellement ni normativement plus “avancés” ⤴️
[12] Cette dynamique n’en relevait pour autant de la nécessité : dans certains pays « arriérés » comme l’Italie, la Russie et le Japon, le capitalisme a avant tout été impulsé par des gouvernements ayant mené ce que Gramsci a désigné comme des « révolutions passives ». Voir Antonio Gramsci, Guerre de mouvement et Guerre de mosition, éd. R Keucheyan, Paris, La Fabrique, 2012. ⤴️
[13] Ernest Mandel, Late Capitalism, Londres, Verso, 1980, p. 60. ⤴️
[14] Paul Bairoch, Mythes et paradoxes de l’histoire économique, trad. fr. A. SaintGirons, Paris, La Découverte, 1999, p.
100. ⤴️
[15] Ibid., p. 105-106. ⤴️
[16] Ibid., p. 107. ⤴️
[17] Ibid., p. 121. ⤴️
[18] Emery K. Hunt et Mark Lautzenheiser, History of Economic Thought: A Critical ⤴️
[19] William McKinley, « Interview with President William McKinley », The Christian Advocate, 22 janvier 1903, en ligne. ⤴️
[20] Freda Harcourt, « Disraeli’s Imperialism, 1866-1868: A Question of Timing », The Historical Journal, no 23, 1980. ⤴️
[21] Eric J. Hobsbawm, The Age of Empire: 1875-1914, New York, Vintage Books, ⤴️
[22] Freda Harcourt, « Disraeli’s Imperialism », art. cité, p. 97. ⤴️
[23] Richard Seymour, The Liberal Defence of Murder, op. cit., p. 47. Pour une critique de la distinction entre peuples historiques et peuples sans histoire, voir Roman Rosdolsky, Friedrich Engels et les peuples « sans histoire ». La question nationale dans la révolution de 1848, Paris, Syllepse, 2018 ; Benjamin Bürbaumer, « L’économie poli- tique de la question nationale », dans Ibid. ⤴️
[24] Bernstein cité dans Richard Seymour, The Liberal Defence of Murder, op. cit., p. 48. ⤴️
[25] Hans-Ulrich Wehler, « Industrial Growth and Early German Imperialism », dans B. Owen et R. Sutcliffe (dir.), Studies in the Theory of Imperialism, Londres, Longman, 1972, p. 88. ⤴️
[26] Eric J. Hobsbawm, The Age of Empire: 1875-1914, op. cit., p. 71. ⤴️
[27] Richard Seymour, The Liberal Defence of Murder, op. cit., p. 45-46. ⤴️
[28] Eric J. Hobsbawm, The Age of Empire: 1875-1914, op. cit., p. 67. ⤴️
[29] Emery K. Hunt et Mark Lautzenheiser, History of Economic Thought, op. cit., p. 349. ⤴️
[30] Ernest Mandel, Marxist Economic Theory II, op. cit., p. 441. Mandel rappelle qu’en termes de développement économique il n’y avait pas de grandes disparités à l’échelle mondiale au milieu du XvIIIe siècle. ⤴️
[31] Mark Rupert et Hazel Smith (dir.), Historical Materialism and Globalisation: Essays on Continuity and Change, Londres, Routledge, 2002, p. 49. ⤴️
[32] Ernst Hanisch, Der grosse Illusionist: Otto Bauer (1881-1938), Vienne, Böhlau Verlag, 2011, p. 74. ⤴️
[33] Rudolf Hilferding, Le Capital financier, Marxists.org, 1910, en ligne. ⤴️
[34] Note de bas de page ⤴️
[35] Karl Marx, Le Capital. Livre III, chapiter XLVIII, Marxists.org, 1867, en ligne. ⤴️
[36] Tom Kemp, « The marxist theory of imperialism », Studies in the Theory of Imperialism, Londres, Longman, 1972, p. 16. ⤴️
[37] Rudolf Hilferding, Le Capital financier, op. cit. ⤴️
[38] Ibid. ⤴️
[39] Eric J. Hobsbawm, The Age of Empire: 1875-1914, op. cit. ⤴️
[40] Rudolf Hilferding, Le Capital financier, op. cit. ⤴️
[41] Trotsky, Léon. Histoire de La Révolution Russe I, op. cit., p. 42. ⤴️
[42] Anthony Brewer, Marxist Theories of Imperialism: A Critical Survey, Londres, Routledge, 1990, p. 97. ⤴️
[43] Rudolf Hilferding, Le Capital financier, op. cit. ⤴️
[44] Anthony Brewer, Marxist Theories of Imperialism, op. cit., p. 100-101. ⤴️
[45] Rudolf Hilferding, Le Capital financier, op. cit. ⤴️
[46] Ibid. ⤴️
[47] Note de bas de page ⤴️
[48] Note de bas de page ⤴️
[49] Bernd Braun, Eine sozialistische Universität? Die Parteihochschule der SPD 1906 bis 1914, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2001. ⤴️
[50] Rosa Luxemburg, « Critique des critiques », Marxists.org, 1913, en ligne. ⤴️
[51] Rosa Luxemburg, L’Accumulation du capital, Marxists.org, 1913, en ligne. ⤴️
[52] Ibid. ⤴️
[53] ontesquieu, De l’esprit des lois, Paris, Flammarion, 1979. ⤴️
[54] John Stuart Mill, cité dans Michael Joseph Smith, « Liberalism and International Reform », dans T. Nardin et David
R. Mapel (dir.), Traditions of International Ethics, Cambridge, Cambridge University Press, 1992. ⤴️
[55] À ce propos Samir Amin parle même du « génie de Rosa Luxemburg ». Voir Samir Amin, « Le commerce international et les flux internationaux de capitaux », L’Homme et la société, no 15, 1970, p. 94. ⤴️
[56] Rosa Luxemburg, L’Accumulation du capital, op. cit. ⤴️
[57] Le fait que l’analyse de la sous-consommation proposée par Luxemburg se soit avérée largement erronée n’ôte pas leur pertinence à ses vues sur l’accumulation primitive, dans la mesure où l’articulation entre les deux phénomènes est moindre qu’elle ne l’avait envisagé. Voir Bob Sutcliffe, « How Many Capitalisms? Historical Materialism in the Debats about Imperialism and Globalization », Historical Materialism and Globalisation: Essays on Continuity and Change, Londres, Routledge 2002, p. 48. Dans son introduction à la version anglaise de L’Accumulation du Capital parue en 1951, l’économiste Joan Robinson précise en effet que si, contrairement à ce que croyait Luxemburg, l’impérialisme n’est pas intrinsèquement nécessaire au capitalisme, il existe une hypothèse plausible sur les origines capitalistes de l’impérialisme qui sauve son argumentation économique sur l’expansion impérialiste. Joan Robinson, « Introduction » à Rosa Luwemburg, The Accumulation of Capital, Londres, Routledge, 1951. L’intégralité du raisonnement est exposée à partir de la page XXV. Pour une critique de l’utilisation luxemburgienne des schémas de reproduction du Capital, voir Roman Rosdolsky, The Making of Marx’s Capital, Londres, Pluto Press, 1977. ⤴️
[58] Anthony Brewer, Marxist Theories of Imperialism, op. cit., p. 71. ⤴️
[59] Nicolas Boukharine, L’Économie mondiale et l’Impérialisme, Paris, Anthropos, 1967, troisième partie. ⤴️
[60] Ibid., p. 11. ⤴️
[61] Lénine, L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme, Marxists.org, 1916, en ligne. ⤴️
[62] Nicolas Boukharine, L’Économie Mondiale et l’Impérialisme, op. cit., p. 56. ⤴️
[63] Nicolas Boukharine, L’Économie Mondiale et l’Impérialisme, op. cit., p. 128. Cet élément permet par ailleurs à Boukharine d’expliquer la crise du parlementarisme de l’époque. ⤴️
[64] Ibid., p. 91. ⤴️
[65] Ibid., p. 102. ⤴️
[66] Lénine, L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme, op. cit. ⤴️
[67] Ibid. ⤴️
[68] Voir Kevin Anderson, Marx aux antipodes. Nations, ethnicité et sociétés non occidentales, trad. fr. M. Chémali et V. Rauline, Paris, Syllepse, 2015. ⤴️
[69] Reinhart Kössler, « Imperialismus und Globalisierung. Anmerkungen zu zwei Theoriekomplexen », Prokla, no 133, 2003, p. 530. ⤴️
[70] Lénine, « L’Impérialisme et la scission du socialisme », Marxists.org, en ligne. ⤴️
[71] Nicolas Boukharine, L’Économie Mondiale et l’Impérialisme, op. cit., p. 170. ⤴️
[72] Alberto Toscano, « De l’aristocratie ouvrière à l’Union sacrée : Du Bois sur les origines coloniales de 1914 », Période, 2014. ⤴️
[73] Karl Kautsky, « Ultra-imperialism », Marxists.org, 1914, en ligne. ⤴️
[74] Lénine, L’Impérialisme, stade suprême du capitalisme, op. cit. ⤴️
[75] Gilber Ziebura, « Interne Faktoren des französischen Hochimperialismus 18711914 », Der moderne Imperialismus, Stuttgart, Kohlhammer, 1971, cité dans Tobias ten Brink, Geopolitik: Geschichte und Gegenwart kapitalistischer Staatenkonkurrenz, Münster, Westfälisches Dampfboot, 2008. ⤴️
Sommaire
- Des fondements violents
- Le développement international du capitalisme
- Le discours public sur la politique d’expansion
- Les débats marxistes classiques, ou l’impérialisme comme stade particulier du capitalisme
- La contribution structurante de Rudolf Hilferding
- L’impérialisme chez Rosa Luxemburg
- Boukharine, Lénine et Kautsky face à la Première Guerre mondiale
Corpus
Voici un ensemble de textes pour vous permettre d’aller plus loin sur ce sujet
- La théorie classique de l’impérialisme, Claudio Katz
- Paru sur Contretemps
- Les théories marxistes de l’impérialisme, Claude Serfati
- Paru sur Période
- La théorie marxiste et les origines de la Première Guerre mondiale, Alexander Anievas
- Paru sur Période
Partager

Comprendre les rapports de domination a l’échelle internationale
Notre groupe de lecture propose un espace d’auto-formation où nous explorons collectivement les enjeux de l’anti-impérialisme et ses résonances dans les luttes contemporaines, de l’écologie à l’antiracisme. Rejoignez-nous pour des discussions enrichissantes et accessibles, ouvertes à toutes et tous, dans une dynamique d’échange et de partage des savoirs.