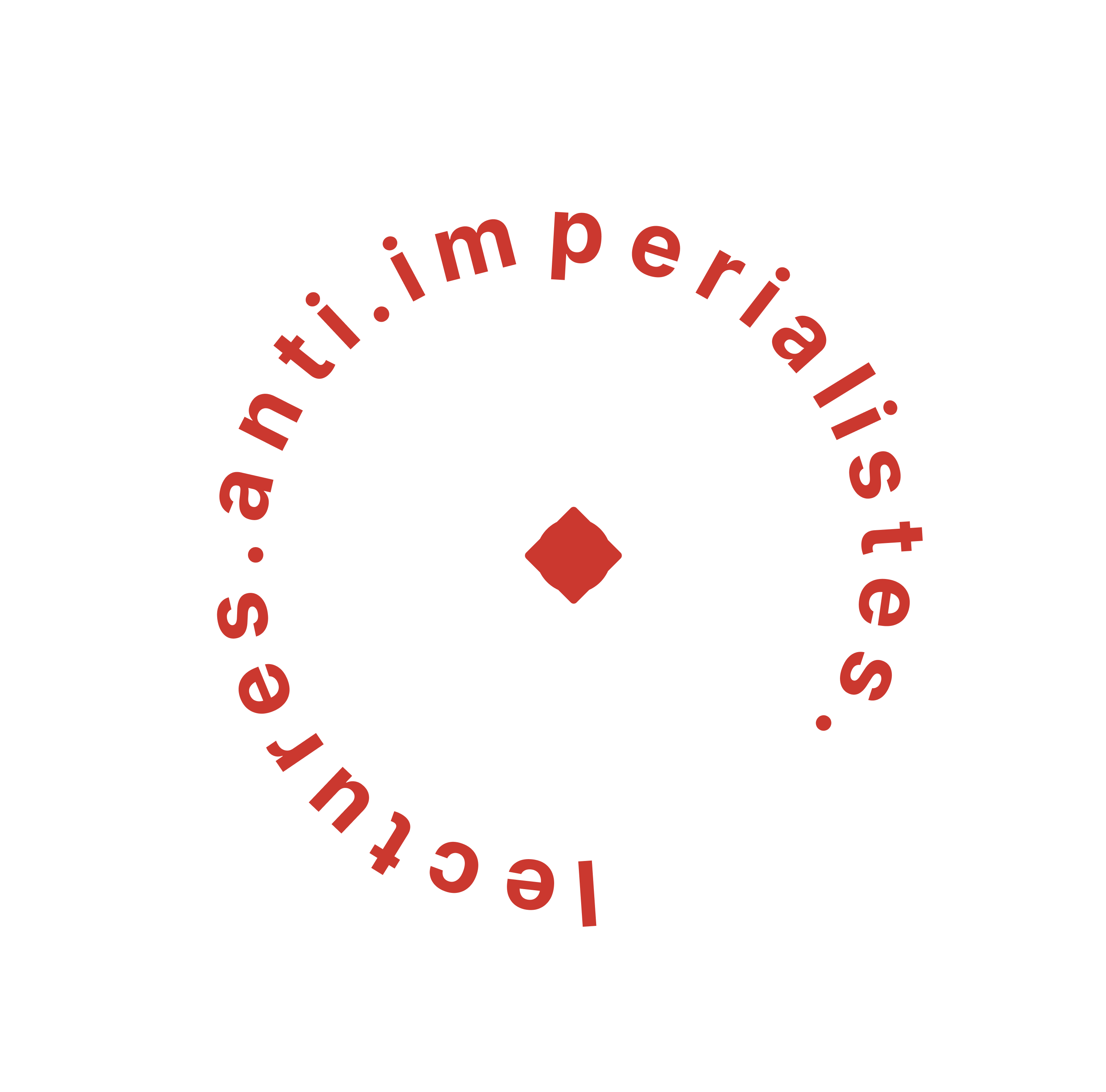Le renouveau de la pensée libérale : les « exemptions suprêmes d’urgence » et le retour de la guerre juste
Ce texte examine la renaissance, après la guerre froide, d’une doctrine libérale justifiant l’usage de la force au nom de la démocratie et de la paix. Il montre comment la théorie de la paix démocratique a légitimé un droit de la guerre fondé sur l’exception, l’urgence et la distinction entre États « bien ordonnés » et « hors-la-loi ». À travers les cas de la guerre du Golfe et du Kosovo, l’article analyse les effets concrets de cette logique sur le droit international et les populations civiles.
Alors que le capitalisme s’impose finalement face au communisme, que la libéralisation de l’URSS s’amorce en 1985, avec la perestroika puis la glasnost, l’administration américaine se cherche un nouvel ennemi, suffisamment crédible pour justifier des budgets militaires conséquents, le maintien et l’entretien de l’alliance militaire de l’OTAN (créée pour faire face au Pacte de Varsovie), et le subventionnement de l’industrie militaro-industrielle par les fonds publics américains. Le haut fonctionnaire Colin Powell, sous les administrations Reagan (1981-1989), Bush senior (1989-1993), Clinton (1993-2001) et Bush junior (2001-2006), sera l’un des personnages-clé de ce renouveau, qui trouvera dans la première guerre du Golfe son laboratoire initial. Les pays qualifiés d’autoritaires, soit la plupart des pays du « Tiers Monde » – pays qui, forts de l’expérience du colonialisme « civilisateur » se sont, dès leur indépendance, empressés de ratifier l’ensemble des conventions de Genève leur assurant une protection en cas de guerre ou de conflit armé sont qualifiés automatiquement d’hostiles à la politique hégémonique américaine et identifiés comme dangereux. En 1982, le Président Ronald Reagan fraîchement élu déclare publiquement adhérer à la thèse de la paix démocratique, qu’il redéfinit comme il suit : tous les États non-démocratiques du monde sont une menace pour les États-Unis et par la même occasion un danger pour le monde. Pour « démocratiser le monde » il crée en l983, le National Endowment for Democracy, sorte de pendant civil de la CIA, dont l’objectif est de soutenir les mouvements démocratiques et, dans certaines limites, d’œuvrer au renversement des régimes autoritaires aux quatre coins de la planète. Le renouveau du projet de démocratie mondiale connaît son apogée à la fin des années 1980, lorsqu’est proclamée, via Francis Fukuyama, alors vice-directeur du think tank de politique étrangère de l’administration américaine, la « fin de l’histoire » : la démocratie libérale, les droits de l’homme et le marché ont triomphé et s’imposent comme la forme d’organisation politique, sociale et économique mondiale. Il faut la promouvoir en dépit des résistances nationales pour assurer la paix mondiale. Cette doctrine n’est pas uniquement proclamée par les États-Unis : elle devient dans le même temps la nouvelle politique officielle des Nations unies. Dans son rapport intitulé « Un Agenda pour la paix », publié en 1992, le Secrétaire général des Nations unies, Boutros Boutros-Ghali, écrit que « la démocratie à tous les niveaux est essentielle pour atteindre la paix, pour une nouvelle ère de prospérité et de justice ». La théorie de la paix démocratique est le nouveau credo des Nations unies. Elle se fonde évidemment sur l’air du temps, délibérément et résolument optimiste : pour créer les conditions de la paix mondiale, il suffit d’installer la démocratie mondiale. Facile ! Les Nations unies y croient sincèrement et s’engagent dans la « démocratisation » du Cambodge après le génocide Khmer Rouge ainsi qu’en ex-Yougoslavie au sortir des guerres des Balkans. Ces deux missions, alors pensées comme marquant le début d’une nouvelle ère de « democracy building » seront des échecs monumentaux, mais les Nations unies n’en ont pas encore conscience. Dans ce contexte, l’état d’urgence fait son apparition dans la théorie du droit de la guerre, ou droit international humanitaire, via deux penseurs américains du libéralisme, parmi les plus influents de la seconde moitié du XXe siècle : Michael Walzer et John Rawls. Ils s’approprient et développent la notion d’« urgence suprême », autorisant une suspension temporaire du droit de la guerre, dans des cas extrêmes, voire toujours lorsqu’il s’agit d’une guerre avec des « États hors-la-loi » ou « faillis », hors du « contrat social international ». Ce faisant, les deux penseurs font renaître la doctrine de la « guerre juste », et de l’« intervention d’humanité », reprise et développée parallèlement par les politistes libéraux américains Michael Doyle, Francis Fukuyama et Larry Diamond, entre autres, et mises en pratique notamment en Irak à partir de 1990.
De Michael Walzer à John Rawls : l’« exemption suprême d’urgence »
Michael Walzer, philosophe américain né en 1935, passe la majeure partie de sa carrière comme professeur à l’université d’Harvard. Dans les années 1970, il relance le débat sur la guerre juste, qui avait été abandonné depuis un demi-siècle par la philosophie politique. Se nourrissant des problèmes philosophiques soulevés par Jean-Paul Sartre et Albert Camus, eux-mêmes largement inspirés par la guerre d’Algérie et la question de la torture, il reformule un certain nombre de questions classiques de la philosophie politique, en particulier celle de l’éthique dans le contexte de la guerre. Dès 1973, il s’intéresse au problème sartrien des « mains sales » dans son article The Problem of Dirty Hands, où sa thèse principale est la suivante : « Il est facile de se salir les mains en politique, et c’est souvent juste de le faire » Pour illustrer son problème, il prend l’exemple, depuis devenu une référence, de la nécessité de torturer pour faire avouer à un terroriste où se trouvent les bombes prêtés à exploser – il s’agit, en l’espèce, d’une guerre coloniale, probablement inspirée de la bataille d’Alger. Pour lui, la guerre juste est une guerre « sans risque », propre en quelque sorte. Étant donné qu’il « est facile de se salir les mains en politique », il y a une tension certaine entre les deux termes du syntagme « guerre juste » mais en aucun cas une contradiction irréconciliable. Dans Just and Unjust Wars (1977), il écrit « la guerre juste est comme un bon gouvernement : il existe une tension profonde et permanente entre l’adjectif et le nom, mais pas nécessairement une contradiction entre eux. » C’est l’application du droit de la guerre qui fait d’une guerre une guerre juste. Néanmoins, il faut accepter des exceptions. Walzer refuse le sitting scale argument selon lequel plus la cause de la guerre est juste, plus celui qui s’en prévaut peut s’affranchir du droit de la guerre, argument qu’il attribue à Hugo Grotius. Un autre argument paraît plus fécond, selon lui, celui de « l’urgence suprême », qui, à l’image de l’état d’urgence en droit national, justifie la suspension du droit. Il emprunte ce terme à Winston Churchill, dans son discours au peuple britannique du 19 mai 1940 expliquant sa décision de raser les villes allemandes en visant spécifiquement les populations civiles via des raids aériens, en totale violation du droit de la guerre alors déjà bien établi et auquel le Royaume-Uni est partie.
Nous nous battons pour ré-établir le règne du droit et protéger les libertés des petits pays. Notre défaite signifierait un âge de violence barbare, et se révélerait fatale, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour chaque petit pays en Europe. Agissant au nom du Pacte de la Société des Nations, au nom de tous les mandataires de la Société et de tout ce qu’elle représente, nous avons le droit, plutôt l’obligation, d’abroger pour un endroit certaines des conventions et des lois que nous cherchons à consolider et à réaffirmer. Les petites nations ne doivent pas nous lier les mains lorsque nous nous battons pour leurs droits et leurs libertés. La lettre de la loi ne doit pas dans une urgence suprême faire obstacle à ceux qui sont en charge de leur protection et de leur mise en œuvre. Il ne serait pas juste ou rationnel que la Puissance agressive puisse obtenir des avantages en violant toutes les lois, et encore en s’abritant derrière le respect inné pour la loi de ses opposants. L’humanité, plutôt que la légalité, doit être notre guide.
Selon Walzer, il s’agit là « d’une des décisions les plus importantes de l’histoire de la guerre ». En effet, comme il le rappelle, cette campagne cause la mort de 300000 civils allemands, et engendre près de 800000 blessés. Aussi, cette politique britannique crée un précédent historique pour les Américains, qui peuvent alors bombarder Tokyo et d’autres villes japonaises, et enfin, larguer deux bombes atomiques sur des populations civiles, à Hiroshima et Nagasaki. Rappelons que la décision de cibler les civils s appelle en droit de la guerre du terrorisme, et c’est d’ailleurs le terme employé par Michael Walzer lorsqu’il établit le décompte : le « bilan des morts civiles causées par le terrorisme des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale a dépassé le demi-million : hommes, femmes, enfants ». Néanmoins, il s’agit là selon lui d’une bonne décision, nécessaire à la victoire militaire. Quelques années plus tard, John Rawls (1921-2002) philosophe américain, reprend les idées de Michael Walzer sur l’exemption suprême d’urgence là où ce dernier les avait laissées. Fervent patriote, ayant décidé volontairement de s’engager dans la Seconde Guerre Mondiale, en Nouvelle-Guinée, aux Philipppines, et au Japon après la défaite de ce dernier, il est comme Walzer professeur a Harvard, où il enseigne la philosophie jusqu’à sa retraite. En 1971 paraît son livre majeur, Théorie de la justice, qui le propulse au rang de philosophe majeur du XXe siècle, rénovateur de la pensée libéral. Il publie également Libéralisme politique en 1978, dans lequel il se revendique de l’héritage de Locke, Kant et Mill, et promet d’actualiser le libéralisme. C’est donc logique qu’en parallèle de son travail sur la théorie de la justice le philosophe américain s’attache à développer une théorie de la guerre juste fondée sur des principes libéraux. Rappelons que Locke et Mill sont des « impérialistes libéraux », persuadés que le droit international ne saurait s’appliquer de la même manière aux nations civilisées et aux nations barbares. Il en va de même pour Kant qui, dans le Projet de Paix perpétuelle, développe l’argument théorique selon lequel les démocraties libérales ne se font pas la guerre entre elles : il en découle une paix « intra-États libéraux ». Ses développements normatifs portent quant à eux sur les conditions de la guerre : seule la guerre de légitime défense est juste, et seulement lorsqu’elle est en conformité avec les lois de la guerre. Mais il formule deux exceptions, à la fois au jus in bello et au jus ad bellum. Concernant le jus ad bellum, il donne, à l’interdiction de la guerre sauf en cas de légitime défense, l’exception suivante les sociétés qui sont dans un état de nature, hors de l’État de droit sont par leur existence une offense à l’endroit des autres nations, ce qui justifie de leur mener la guerre de façon préventive, même en l’absence de dommage directe. Par ailleurs, en matière de jus in bello, contre les ennemis « injustes », hors de l’État de droit, dans l’état de nature, les lois de la guerre ne sont pas non plus applicables. Ni jus ad bellum ni jus in bello pour les ennemis de la liberté ? Dans son livre The Law of Peoples publié en 1999, Rawls reprend ces exceptions. Soucieux d’inscrire son redéploiement de la doctrine de la guerre juste dans le cadre de la théorie kantienne de la paix démocratique, Rawls écrit : « Depuis Montesquieu, les auteurs de la tradition libérale ont souvent considéré que la démocratie constitutionnelle combinée au commerce mènerait à la paix entre les nations. Le projet de Paix perpétuelle de Kant (1975) montre la voie ». Mais d’abord, il se pose une question historique : comment des nations démocratiques, ou avec une forte historie démocratique, se sont-elles ruées à la guerre les unes contre les autres, contre la théorie de la paix démocratique ? Analysant les causes de la Seconde Guerre mondiale, il conclut, plutôt que de désavouer la théorie kantienne de la paix démocratique, que si certaines démocraties sont devenues agressives, c’est parce qu’elles s’étaient transformées en « outlaw » States, en États « hors du droit ». Dès lors, il est justifié, pour Rawls, reprenant Kant, que les sociétés démocratiques s’engagent dans des guerres préventives et même attaquent les populations civiles s’il s’agit de neutraliser des États hors du droit ou en passe de le devenir. C’est ainsi que Rawls considère que les bombardements de Hambourg et Berlin – le rasage de ces villes et le ciblage des populations civiles, hommes, femmes et enfants – se justifie. C’est ce qu’il appelle « l’exemption de l’urgence suprême », rajoutant un mot à l’expression de Walzer, qu’il cite en note de bas de page. Il définit cette exemption comme suit :
L’Exemption Suprême d’Urgence. Cette exemption nous autorise à mettre de côté – dans certaines circonstances spéciales – le statut de civils qui les protège des attaques directes en contexte de guerre.
Alors que pour lui, les bombardements d’Hiroshima et de Nagasaki ainsi que de Dresde, en 1945 à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sont injustifiés, ce n’est pas le cas de ceux d’Hambourg et de Berlin en 1940. Pourquoi une telle différence ? Parce que selon Rawls, l’issue de la Seconde Guerre mondial était incertaine lorsque Hambourg et Berlin ont été attaquées – le Royaume-Uni n’avait pas d’autre option pour éviter un mal plus grand encore, la victoire de l’Allemagne nazie. Alors que pour les bombardements de Hiroshima, Nagasaki ou Dresde, l’issue était déjà décidée – les morts civiles étaient alors tout à fait inutiles. Rawls peut donc conclure qu’en cas d’urgence suprême, le ciblage de populations civiles est justifié. Mais pas dans les circonstances normales de guerre, où les conventions du DIH s’appliquent. Cette conclusion est plus humaniste que celle appliquée par le tribunal de Nuremberg en 1945, qui considère alors les bombardements de Berlin au même titre que ceux d’Hiroshima comme ne violant aucun des principes des conventions de la Haye. Reprenant Kant, Rawls affirme que les sociétés démocratiques ont le droit de protéger leurs principes démocratiques contre les États « outlaw », ceux qui violent le contrat social international. Qui sont ces outlaw ? Le monde décrit par Rawls n’est pas explicitement divisé en « civilisé » et « non-civilisé » ; mais il est divisé en deux entre les « peuples bien ordonnés » et « les peuples pas bien ordonnés ». Parmi les peuples bien ordonnés on trouve les « peuples libéraux raisonnables », c’est-à-dire les sociétés démocratiques libérales, et les « peuples décents », ayant un système hiérarchique constitutionnel décent, ce qui n’est pas très clair. Parmi les peuples « pas bien ordonnés », il y a les « États hors la loi », les « États aux conditions non-favorables », et « les absolutismes éclairés ». Parmi ces catégories, les « États hors la loi » font l’objet de développements particulièrement détaillés. Il s’agit des « régimes [qui] refusent de se plier à un droit des peuples raisonnable ». La communauté internationale, ou ce que Rawls appelle « la société des peuples » est uniquement ouverte aux « peuples bien ordonnés », excluant de facto la majorité du monde, composée de « peuple pas bien ordonnés ». Ainsi, Rawls fait la différence entre les « peuples libéraux, bien ordonnés, décents » et les autres, les peoples « outlaw », « pas bien ordonnés, pas libéraux, indécents ». Seuls les nations et peuples libéraux, membres de la « société des peuples » ; peuvent faire des guerres justes et uniquement avec les peuples non libéraux. Les guerres des peuples non libéraux sont quant à elles forcément injustes. En effet, les États « pas bien ordonnés » ont par nature des buts expansionnistes qui menacent la sécurité et les institutions libres des régimes « bien ordonnés » et sont la cause des guerres dans le monde. Faisant écho aux déclarations de Ronald Reagan, Rawls en conclut que leur simple existence est une menace pour le monde. II propose ensuite son projet propre de paix perpétuelle, identifiant huit principes de droit international pour y concourir. Parmi eux, le huitième principe consiste, pour les nations libérales, en un devoir d’assistance aux nations « moins favorisées » n’ayant pas la chance d’avoir un régime politique « juste ou décent ». Cette thèse annonce la mutation de la doctrine de l’intervention d’humanité en « responsabilité de protéger », qui porte en elle les germes de la politique de « regime change ».
De Michael Doyle à Larry Diamond : la « guerre pour la paix libérale »
La renaissance de la « théorie de la paix libérale-démocratique » à cette époque n’est pas seulement le fart de philosophes libéraux. Dans sa dimension plus « appliquée », elle est surtout l’œuvre de politistes, en particulier les libéraux Michael Doyle, Francis Fukuyama, Larry Diamond, tous trois professeurs de science politique des grandes universités américaines, et très influents au sein des think tanks murmurant à l’oreille du Secrétariat général des Nations unies et du gouvernement américain – « démocrate » comme « républicain ». Michael Doyle, né en 1948, actuellement professeur de science politique à l’université de Columbia à New York, se proclame comme Rawls l’héritier de Kant et de Mill – à chacun desquels il consacre un livre. Dans son article Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs, publié en 1983, Doyle rappelle que les guerres ont lieu principalement entre États libéraux et non libéraux ; les guerres préventives contre les États non libéraux se justifient donc au nom de la paix. Et de citer le discours d’entrée en guerre de Woodrow Wilson devant le Congrès américain du 2 avril 1917, avant de revenir à Kant : il faut que la « paix intra-libérale » devienne universelle, et pour cela, que le monde devienne libéral-démocratique, par la force si nécessaire. Il faut maintenir à tout prix l’hégémonie américaine sur le monde, car les États–Unis sont les seuls capables de supporter le fardeau de la démocratisation globale… Chez Doyle, comme chez Rawls, Mill, Kant ou Locke, on retrouve l’idée que les peuples libéraux sont fondamentalement et radicalement différents du reste du monde – ils sont tout simplement supérieurs et ont à ce titre, une mission de promotion de la démocratie dans le monde. Doyle reconnaît néanmoins que « le libéralisme semble bien exacerber les interventions contre les États non libéraux faibles et l’hostilité contre les États non libéraux puissants. » Mais enfin, de là à remettre en cause l’hégémonie des États-Unis… « Le déclin de l’hégémonie américaine serait un danger pour le monde libéral ». Dans La Fin de l’Histoire, publié en 1989, Francis Fukuyama est d’accord. La guerre est désormais improbable parmi les démocraties avancés. Le conflit, cependant, est toujours d’actualité, entre les États encore « historiques » et les autres déjà « post-historiques ». Si les démocraties libérales « post-historiques », ayant atteint « la fin de l’histoire », ne se font plus la guerre entre elles, en revanche, les nations « bloquées dans l’histoire » restent une source de conflits potentiels. Et d’ajouter : « La force continuera d’être l’ultima ratio des relations mutuelles [entre nations historiques post-historiques] ». À moins que ces nations ne soient civilisées sur la voie de la démocratie libérale. Pour ce faire, il propose, dans Foreign Affairs, quelques années plus tard, et toujours en s’appuyant sur Kant une fédération de démocraties en armes : il faut s’appuyer sur une « ligue internationale des démocraties », à vocation militaire, à même de détrôner les « menaces émanant des parties non démocratiques du monde ». L’ONU, composée majoritairement de pays aux régimes non libéraux, n’est pas le bon forum. Seule l’OTAN répond au double critère libéral-démocratique et militaire. L’idée de la nécessité de maintenir une ligue armée de démocraties libérales ayant pour mission le regime change aux quatre coins du monde devient « mainstream » dans les think tanks de politique étrangère et est officiellement adoptée an cours du mandat de Bill Clinton sur la base du son rapport « An American Foreign Policy for Democracy », écrit en 1991 par le politiste libéral Larry Diamond sur commande du Parti démocrate. L’OTAN, comme alliance globale de démocraties, est alors promue par l’administration Clinton précisément au nom de cette théorie. En 1995, Diamond publie « Promoting Democracy in the 1990s » : les États-Unis sont face à une opportunité historique de « redessiner le monde » à leur image. La sécurité du pays dépend de sa capacité à « démocratiser » les autres nations. Diamond est catégorique : les transitions démocratiques peuvent être imposées ou décrétées (« engineered ») par un État étranger et ce, quelle que soit la réalité de conditions socio-économiques ou culturelles du pays en question. Alors, par quels pays commencer ? Selon Diamond, les États-Unis doivent donner la priorité aux opérations de « changement de régime » dans les pays « importants à l’égard de la sécurité des États-Unis et de la sécurité régionale et globale plus généralement ». Mais encore ?
Dans un article très influent publié au même moment dans Foreign Affairs, l’ancien conseiller à la Sécurité Nationale Anthony Lake désigne cinq États comme prioritaires : Iran, Corée du Nord, Libye, Cuba et Irak. « Notre politique doit faire face à la réalité des États récalcitrants et hors-la-loi qui choisissent de rester en dehors de la famille des nations mais également d’attaquer ses valeurs fondamentales ». Ces États ont « une incapacité chronique à construire des relations constructives avec le reste du monde ». À l’image de ce que les États-Unis avaient fait pour contrer l’expansionnisme soviétique, ils ont désormais une responsabilité de « neutraliser » et « contenir » ce groupe d’« états voyous » (rogue states) résistant à l’hégémonie américaine, à l’instar de la première guerre du Golfe.
Mise en pratique : les États-Unis face à l’Irak dans la première guerre du Golfe
À la suite de l’invasion du Koweït par l’lrak en août 1990, ce dernier est soumis a un régime de sanctions internationales, au titre de l’article 41 du chapitre VII de la Charte des Nations unies. Les sanctions sont imposées le 6 août 1990 par la résolution 661 du Conseil de sécurité. Dans le comité des Nations unies formé pour évaluer et ajuster la politique de sanctions dans le temps, le comité 661, les États-Unis et le Royaume-Uni demandent l’imposition de sanctions sur toutes les importations et les exportations de tous les produits sans exception, y compris nourriture et médicament, mettant en avant la potentielle « utilisation duale » de ces derniers à des fins civiles et militaires. Les premières victimes des sanctions sont les enfants et les populations vulnérables – malades, personnes âgées. Au moment de son adoption, les sanctions sont envisagées comme une mesure temporaire jusqu’au retrait irakien – même si la résolution ne le précise pas textuellement. Au bout de six mois, alors que l’Irak continue à occuper le Koweït, les États-Unis décident d’intervenir militairement. Sous l’impulsion des États-Unis, une coalition internationale de plus de trente États se prépare à l’intervention militaire, avec l’objectif « guerre juste » de restaurer le statu quo pré-invasion : retrait de l’Irak au niveau des frontières antérieures. L’objectif des États-Unis va au-delà de cet objectif, visant au désarmement de l’Irak. Pour convaincre le Congrès américain d’autoriser cette aventure – le souvenir du désastre vietnamien est encore frais – le gouvernement organise une campagne de témoignages sur les exactions « contraires aux lois de la nature » des Irakiens au Koweït, C’est le fameux récit des « bébés arrachés des couveuses et jetés par terre par les Irakiens dans les maternités du Koweït » – témoignage d’une jeune koweïtienne s’étant révélée par la suite être la fille de l’ambassadeur à Washington. Saisi par l’émotion de cette jeune fille, le Congrès approuve l’opération. Les États-Unis promettent une « guerre propre » « sans risque », grâce à des « frappes chirurgicales ». L’opération militaire à proprement parler, baptisée « Tempête du désert » commence en janvier 1991 et dure à peine plus d’un moins. Néanmoins, la campagne de bombardements de la coalition internationale (un total de près d’un million d’hommes), semble bien viser l’infrastructure civile de l’Irak, plutôt que des objectifs militaires : les stations électriques et les usines de traitement des eaux sont systématiquement bombardées, plongeant le pays dans l’ère pré-industrielle, sans électricité ni eau. Les armes de la coalition utilisent des armes à l’uranium appauvri (déclarées illégales par les Nations unies en 1996), aux conséquences durables sur les populations (cancers, malformations congénitales, fausses couches, etc.) Pourtant, la guerre est présentée dans les media, conformément à ce qui avait été annoncé, comme une guerre juste, propre, de « frappes chirurgicales ». Finalement, en mars 1991, après une médiation russe, les forces irakiennes se retirent du Koweït et sont encore bombardées lors de leur retrait. Après la restauration des frontières, les sanctions à l’égard de l’Irak sont tout de même maintenues – décision du comité 661. Le Conseil de sécurité vote néanmoins pour lever l’interdiction de l’importation de médicaments mais « uniquement et strictement à des fins médicales et humanitaires ». En 1995, par sa résolution 986, il établit le programme « Oil-for-food» permettant à l’Irak d’importer de la nourriture. Mais impossible de réparer les infrastructures électriques permettant d’assurer le traitement des eaux et de faire fonctionner les hôpitaux, résultant en une surmortalité record, surtout infantile. Interrogée dans une émission sur CBS le 12 mai 1996, appelée Punishing Saddam, au sujet des 500 000 enfants de moins de cinq ans qui seraient directement morts de l’application des sanctions (soit « davantage qu’à Hiroshima et Nagasaki », selon les termes de la journaliste) Madeleine Albright, alors ambassadrice aux Nations unies et responsable de la politique de sanctions vis-à-vis de l’Irak, affirme : « oui, nous pensons que [ces 500 000 enfants morts] valent le coup ». Il est à noter que les bombardements des populations civiles, interdits par les conventions de la Haye et de Genève, avaient pu être interprétés, à Nuremberg en 1945, comme acceptables à condition qu’ils visent effectivement à raccourcir la durée de la guerre et soient immédiatement liés à la victoire militaire. C’est en partie grâce à cet argument juridique que les Alliés avaient échappés aux poursuites pour crime de guerre durant la Seconde Guerre mondiale, en dépit des événements déjà évoqués de Berlin, Hambourg, Dresde, Hiroshima et Nagasaki. Le cas de la guerre du Golfe en 1991 neutralise encore davantage le droit de la guerre : les bombardements effectués par l’armée américaine et la coalition sur les infrastructures civiles n’ont en effet pas de but militaire direct. Comme reconnu par les autorités américaines, il s’agit par cette stratégie d’empêcher durablement le pays de pouvoir se reconstruire, reconstituer ses capacités après la guerre, et surtout, plonger la population dans un état de misère telle qu’elle se soulève contre Saddam Hussein et que se produise le « changement de régime » tant désiré par Washington. Les sanctions imposées en 1990 par le Conseil de sécurité des Nations unies durent en tout 13 ans : elles sont finalement levées en mai 2003 – environ trois mois après l’invasion américaine visant à « amener la démocratie en Irak en renversant directement Saddam. Pour essayer de convaincre le Conseil de sécurité, Colin Powell montre à l’assistance une fiole contenant des « preuves » que le « rogue » Saddam Hussein dispose « d’armes de destruction massive » et prononce un discours mêlant Walzer, Rawls, Diamond, Fukuyama et Doyle. Mais le Conseil de sécurité des Nations unies est moins impressionnable que le Congrès américain, et la résolution qui, au titre des pouvoirs d’urgence de I’ONU, pourrait autoriser, comme en 1990, l’intervention, est refusée. Les États-Unis iront tout de même, grâce à « l’alliance militaire de démocraties du monde libre » que représente l’OTAN. Ce qui caractérise les théories comme les pratiques libérales des relations internationales est qu’elles commandent de distinguer les États en fonction de leur régime politique et de leur idéologie, et de leur appliquer un droit international différencié sur ce fondement. Le droit international n’est opérationnel qu’entre les États libéraux, alors que les États non libéraux sont situés dans une sorte de zone de non-droit, hors des traités, quand bien même ils les ont ratifiés. De nombreux universitaires et conseillers en politique étrangère américains, comme Robert Kagan, reprennent le thème kantien de la « paix intra-libérale » pour la transformer en une doctrine de la « guerre d’imposition de la démocratie » dans le monde : comme pour l’empire britannique au XIXe siècle, il faut exporter la « liberté » par la guerre – si possible via une « Communauté des Démocraties » en armes. L’expansion de l’OTAN est directement liée à cette doctrine – après l’Allemagne de l’Est en 1990, la République tchèque, la Hongrie, et la Pologne sont intégrées dès 1999. Dès que les pays de l’ancien Pacte de Varsovie deviennent des démocraties, ils sont invités à rejoindre l’OTAN. Sous l’impulsion de la secrétaire d’État d’origine tchèque Madeleine Albright, un Conseil pour la Communauté des Démocraties est fondé en 2000, établi à Varsovie, – quel symbole – et chargé de diviser le monde entre des zones de « paix libérale-démocratique » et le reste du monde – à « libérer ».
La France, le Kosovo, et l’« Intervention humanitaire » de 1999
L’« Intervention humanitaire » de l’OTAN au Kosovo, à laquelle participe la France, demeure encore aujourd’hui extrêmement controversée. Pour cette opération militaire au sein d’un État souverain, la Yougoslavie, l’OTAN n’a pas même cherché à obtenir une résolution du Conseil de sécurité. L’organisation décide, unilatéralement, de mener une guerre au cœur de l’Europe, pour sauver les Albanais du Kosovo d’un « génocide » serbe qui serait en préparation sous les ordres de Milosevic. De mars à mai 1999, l’opération est une guerre aérienne totale, visant les centres urbains et surtout la capitale Belgrade : ponts, hôpitaux, chaînes de télévision, écoles, trains transportant des civils, quartiers résidentiels, et même ambassades – notamment l’ambassade de Chine –, en violation totale du principe de distinction au cœur du droit de la guerre. Au cours de la campagne de bombardements de trois mois –78 jours exactement –l’aviation otanienne largue plusieurs dizaines de milliers de bombes sur la Serbie. Les bombes utilisées, à sous-munitions et à uranium appauvri, sont interdites par les conventions internationales.
Pour justifier cette intervention, l’OTAN n’essaie pas de se prévaloir d’un quelconque « droit de légitime défense » – rappelons que l’OTAN se définit comme une « alliance défensive » de démocraties -, mais présente un ensemble d’arguments fondés sur des considérations humanitaires. Dans un communiqué de presse en date du 23 mars 1999, Javier Solana affirme que les actions militaires sont initiés pour « soutenir les buts politiques de la communauté internationale », martelant que « l’OTAN n’est pas en guerre contre la Yougoslavie ». Au Conseil de sécurité, la Russie et la Chine condamnent l’intervention otanienne, dénonçant « une agression ouverte, constituant une « violation manifeste de la Charte des Nations unies ainsi que des normes coutumières du droit International », et créant « un précédent dangereux menaçant l’ordre International ». Chine et Russie présentent un projet de résolution en ce sens : mais cette résolution ne récolte que le vote d’un membre additionnel (Namibie) sur les treize potentiels au Conseil de sécurité. La résolution 1244 du Conseil de Sécurité, autorisant en juin 1999, soit après la fin du bombardement « humanitaire », une force onusienne de transition pour le Kosovo, légitime rétroactivement l’opération otanienne.
Notes
CORPUS
Titre de l’article super intéressant de Auteur
Titre de l’article super intéressant de Auteur